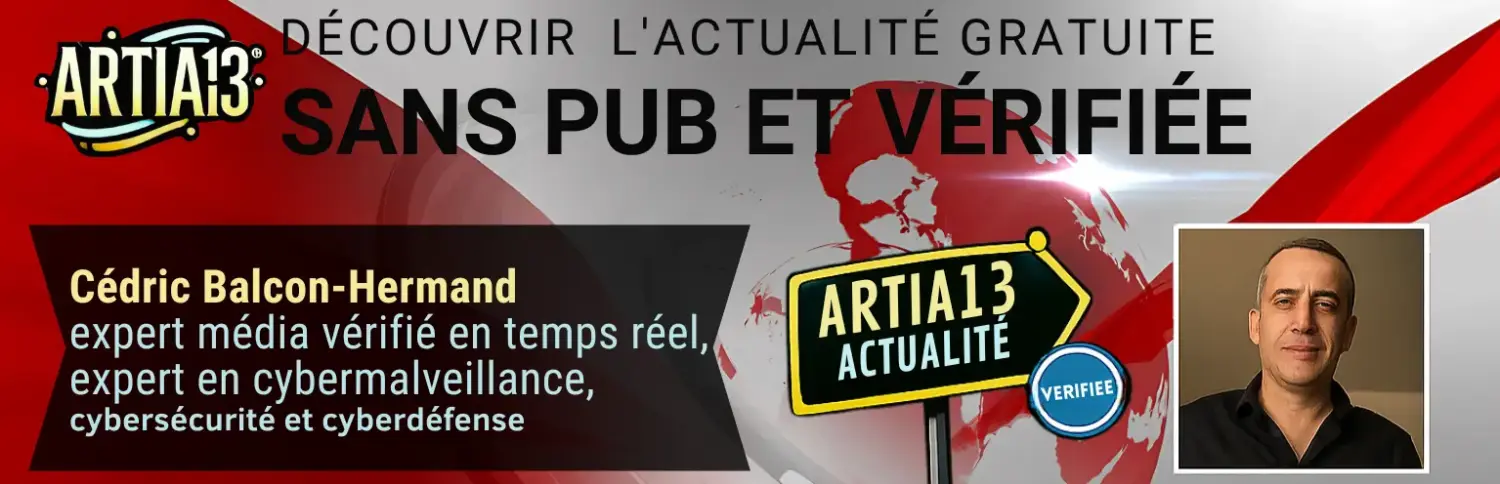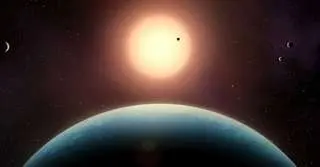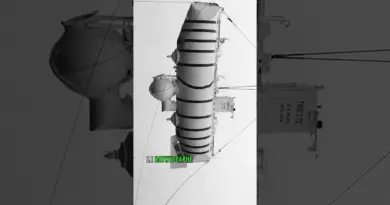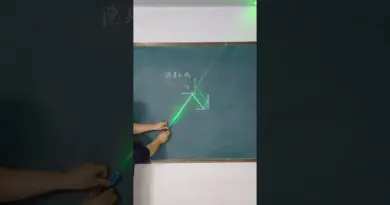« Allô… la Chine ? » La question a semblé flotter dans les chancelleries durant la guerre entre Israël et l’Iran. Si les lignes ont chauffé à Washington, Paris ou Moscou, celle de Pékin est restée désespérément « hors réseau ». Et son silence, autrefois vu comme une forme de sagesse, commence à être interprété comme une fuite. Dans un monde où l’on attend des puissances qu’elles prennent position, la Chine pourra-t-elle jouer la carte de la retenue sans se voir mise à l’écart ?
À mesure que le Moyen-Orient se transforme sous l’impact des rééquilibrages mondiaux, Pékin tente de consolider sa présence dans la région à travers des relations économiques avancées et la protection de ses voies commerciales, tout en appliquant sa politique de non-ingérence. Pour l’instant, la Chine avance à pas feutrés. Elle refuse de choisir entre les blocs rivaux, préférant signer des contrats tous azimuts et multiplier les investissements – une manière de garder de bonnes relations aussi bien avec l’Arabie saoudite qu’avec l’Iran, avec Israël qu’avec la Palestine, avec l’Égypte qu’avec le Qatar, sans provoquer de ruptures diplomatiques majeures.
Cette approche est aujourd’hui particulièrement mise à l’épreuve : guerre à Gaza, effondrement du régime syrien, affrontements entre Israël et le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, guerre entre Israël et l’Iran, tensions autour du détroit d’Ormuz, sans oublier le retour en force des États-Unis.
Le paradoxe de l’équilibre silencieux : Pékin face au dilemme Iran–Israël
Face au conflit opposant l’Iran à Israël, la diplomatie de la Chine oscille entre une rhétorique de neutralité et un pragmatisme aligné sur ses intérêts structurels. Si elle reste fidèle à sa doctrine fondamentale de non-ingérence, de respect de la souveraineté et de résolution pacifique des différends, cette approche se traduit dans la pratique par une stratégie d’évitement.
Pékin s’abstient de prendre position. Face aux violences visant les civils, la République populaire de Chine (RPC) omet de désigner un agresseur. Elle appelle au « dialogue », mais sans prendre d’initiative concrète, et sans proposer de mécanisme institutionnalisé. Elle déplore certes les tensions, mais sans exprimer de prise de position claire sur le fond. Cette prudence sélective dessine les contours d’une diplomatie du « clair-obscur », une neutralité performative, qui feint l’équilibre tout en préservant des préférences tacites. Bien qu’efficace à court terme pour préserver ses relations avec des acteurs aux intérêts contradictoires, cette stratégie engendre un déficit de lisibilité stratégique.
En effet, elle brouille les perceptions sur la volonté réelle de la Chine à agir en tant que puissance stabilisatrice et renforce l’idée d’une actrice réticente à assumer des responsabilités systémiques.
Pourtant, le conflit irano-israélien ne constitue nullement une crise périphérique pour les intérêts chinois. Il affecte trois axes structurants de la stratégie globale de Pékin :
-
La sécurité énergétique : la Chine, premier importateur mondial de pétrole brut depuis 2017, n’a pas réussi à réduire sa dépendance aux importations en provenance du Moyen-Orient. La zone lui fournit près de la moitié des 11 millions de barils de pétrole par jour qu’elle importe aujourd’hui. Ainsi, une aggravation du conflit ou son extension au détroit d’Ormuz ou dans les zones de transit du Golfe menacerait la continuité de ses approvisionnements, avec des conséquences économiques immédiates, alors que sa situation interne dans ce domaine est déjà problématique.
-
La stabilité des corridors de la BRI : les principaux tracés des nouvelles Routes de la soie (Belt and Road Initiative, BRI), terrestres (par l’Iran, le Pakistan, l’Asie centrale) ou maritimes (par la mer Rouge et le canal de Suez), traversent des zones potentiellement touchées par le conflit. L’extension de la guerre toucherait non seulement la sécurisation de ces routes, mais aussi la rentabilité des investissements et la crédibilité des engagements pris auprès des partenaires régionaux.
-
La réputation internationale de la Chine comme puissance responsable : en prétendant incarner une alternative à l’unilatéralisme des États-Unis, le gouvernement chinois est naturellement scruté quant à sa capacité à limiter, contenir ou résoudre les conflits. Son inaction et son silence prolongés face à des crises majeures pourraient ternir l’image qu’il cherche à projeter : celle d’un acteur global constructif, promoteur du multilatéralisme et du dialogue, et porter ainsi atteinte à sa crédibilité.
La prudence chinoise peut s’expliquer par la complexité de ses relations avec les deux protagonistes du conflit. D’un côté, la RPC entretient un partenariat stratégique approfondi avec l’Iran, notamment dans les domaines énergétique, sécuritaire et diplomatique. De l’autre, elle bénéficie d’une coopération technologique de haut niveau avec Israël, cruciale pour sa stratégie d’autonomie industrielle et sa compétition avec les États-Unis.
Dans ce contexte, il serait risqué pour la Chine de privilégier l’un au détriment de l’autre. Cette position intermédiaire la pousse à adopter une diplomatie d’équilibriste, marquée par l’absence de médiation directe ou d’initiative publique, de peur d’altérer ses intérêts de part et d’autre.
Pékin avance donc avec la plus grande prudence, soucieuse de préserver un équilibre fragile entre deux partenaires que tout oppose.
Le précédent irano-saoudien : un tournant diplomatique ou une exception conjoncturelle ?
La réconciliation historique entre l’Arabie saoudite et l’Iran, conclue à Pékin en mars 2023, a marqué un tournant pour la diplomatie chinoise au Moyen-Orient. Pour la première fois, la Chine ne se limitait plus à son rôle d’investisseur majeur ou de partenaire commercial discret : elle endossait celui de médiateur, capable de réunir deux puissances rivales autour d’un langage commun : non-ingérence, dialogue, respect mutuel.
Spectaculaire et habilement mise en scène, cette séquence a nourri l’idée d’un basculement stratégique : celui d’une Chine qui ne se contentait plus d’observer, mais qui commençait à agir en puissance stabilisatrice, à l’heure où les États-Unis semblaient décrocher.
Mais cette « réussite », aussi saluée soit-elle, reste aujourd’hui l’exception plutôt que la norme. Elle a été rendue possible par un alignement rare de facteurs favorables : une lassitude croissante des deux camps, usés par des années de rivalité indirecte aux conséquences de plus en plus coûteuses – au Yémen, au Liban, à Bahreïn. Et, plus largement, un vide relatif laissé par le désengagement américain, dont la Chine a pu profiter, en s’appuyant sur un processus de rapprochement Riyad-Téhéran très avancé et le travail majeur déjà réalisé par les médiateurs régionaux comme Oman ou l’Irak. Pékin n’a au final joué qu’un rôle marginal, offrant surtout un lieu pour orchestrer la conclusion de l’accord.
Le pari du silence : une puissance mondiale peut-elle rester à l’écart ?
Au‑delà de la gestion immédiate des tensions, le face‑à‑face Iran–Israël pose à Pékin une question plus fondamentale : la Chine est‑elle prête à endosser le rôle d’une puissance normative – capable de proposer une architecture de sécurité, de trancher dans les crises asymétriques, et de réguler l’ordre international – ou préfère‑t‑elle demeurer une « puissance d’infrastructure » dont l’influence repose surtout sur le commerce et l’investissement, sans véritable socle politique ?
Cette posture du silence maîtrisé atteint aujourd’hui ses limites. Elle suscite une série de paradoxes. Sur le plan géopolitique, le refus d’assumer un rôle plus affirmé dans les zones de crise pourrait entamer les prétentions chinoises à un leadership global. Sur le plan normatif, l’absence de condamnation claire face à certaines formes de violence – en particulier les bombardements indiscriminés – alimente un sentiment d’ambiguïté dans le monde arabe. Enfin, sur le plan stratégique, la volonté de ménager simultanément des partenaires aux intérêts irréconciliables, comme l’Iran et Israël, pourrait finir par aliéner les deux.
La véritable question, dès lors, n’est pas tant de savoir si la Chine peut rester silencieuse, mais combien de temps encore ce silence pourra être interprété comme diplomatie « d’intelligence », et non comme un signe d’impuissance stratégique.
La ligne est-elle occupée ou coupée ?
Alors, « Allô… la Chine ? » Est-ce un silence tactique, un calcul à long terme, ou un aveu des limites de sa diplomatie et de sa puissance ? Probablement un peu des trois.
La Chine parle, mais à sa manière : par le commerce et par les infrastructures. Le silence, jusqu’à présent, a été dans son intérêt, mais dans un monde où la parole est une arme de positionnement, ce silence peut aussi devenir une forme de message ambigu, voire risqué.
Pour Pékin, le Moyen-Orient est peut-être encore un théâtre secondaire. Mais pour beaucoup de pays de la région, la question reste entière : la Chine peut-elle réellement être un partenaire de paix… si elle se tait quand tout brûle ?
![]()
Nadine Loutfi travaille au Centre Public d’Action Sociale à Etterbeek (Bruxelles). Elle est membre des centres de recherches REPI, EASt et OMAM, dans le cadre de son doctorat en Relations Internationales à l’Université Libre de Bruxelles.
Auteur : Nadine Loutfi, Sciences politiques, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Aller à la source