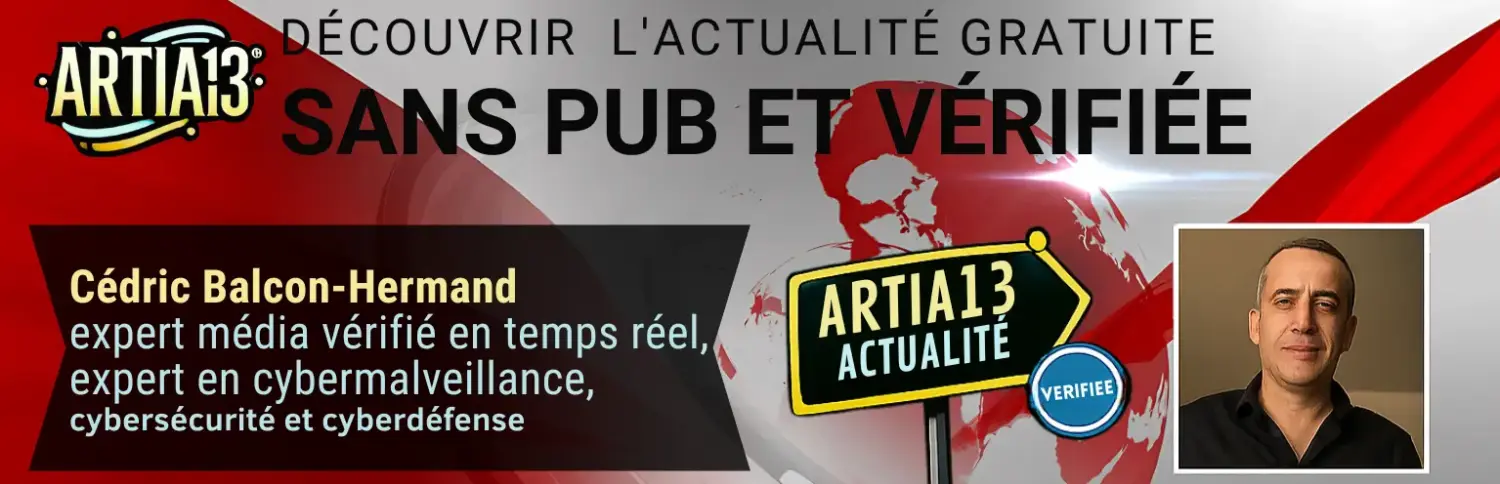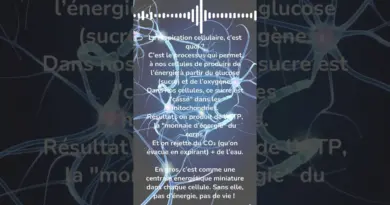Notre démocratie est en crise, comment la réinventer ? Que nous enseignent ceux qui, au cours des âges, furent ses concepteurs ? Troisième volet de notre série consacrée aux philosophes et à la démocratie avec Nicolas Machiavel (1469-1527). Pour le Florentin, la conflictualité est un horizon politique indépassable : le « peuple » doit être armé pour ne pas subir la tyrannie des « Grands » et les républiques doivent être puissantes pour ne pas subir l’impérialisme des États voisins.
Machiavel est un penseur qui fait de la survie et de la fondation des États un enjeu fondamental. Pour celui qui exerça les fonctions de haut fonctionnaire de la République florentine, la question du régime politique est donc subordonnée à celle de la survie dans un contexte toujours marqué par l’horizon de la guerre.
Le meilleur régime est forcément celui qui assure à la fois la liberté et la puissance et qui permet de fonder l’État dans la durée. La science politique qu’il inaugure ainsi n’est plus une réflexion théorique, mais bien un programme politique articulant l’idéal au pragmatisme.
Un républicanisme originel et fondateur
Machiavel n’est pas à proprement parler un penseur de la démocratie. C’est un républicain convaincu. Les républicains de son époque entendent élargir la base du gouvernement et intégrer cette classe moyenne dans une vie politique qui, traditionnellement, est réservée aux aristocrates. Le choix, par Machiavel et par ses contemporains voire par la tradition florentine de parler de « République », indique un régime où, comme sous Rome, tout le monde n’est pas forcément citoyen.
Pour les républicains, jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’élargissement voire l’universalisation de la citoyenneté constituera une question essentielle. Étant donné que la classe moyenne augmente peu à peu dans le temps pour atteindre une proportion très importante, voire majoritaire, de la population européenne, le républicanisme, dans ces conditions, s’articule avec une citoyenneté universellement attribuée aux membres de la société et peut alors se proposer comme le fondement théorique des démocraties modernes puis contemporaines.
L’horizon de la puissance
Du point de vue intérieur, Machiavel estime que la division sociale est inévitable et que le rôle d’un système légal consiste à la laisser s’exprimer tout en l’arrêtant dans ses manifestations les plus extrêmes. Comme il le souligne, les Grands veulent naturellement dominer, il faut donc les arrêter pour qu’ils ne tyrannisent pas. Le « peuple » (entendre les « classes moyennes ») veut seulement ne pas être dominé, par conséquent, il faut lui donner les armes qui lui permettront de constituer un contre-pouvoir envers la tyrannie potentielle des Grands.
Le monde de Machiavel est belliciste, la puissance est à la fois le gage de la survie et l’outil pour conquérir. Si le peuple peut se contenter de n’être pas asservi, une société, dans un monde instable, se doit d’être puissante. La politique se constitue dans l’articulation bien pensée à la fois de ce qu’elle est sur le fond, la recherche d’un vivre-ensemble viable, et de sa situation dans le monde, composée par ses interactions inévitables avec les autres entités politiques.
Pour Machiavel, le monde politique n’est pas chrétien : son fondement, celui de toute société, reste l’appétit de chacun. Si nous étions tous des saints chrétiens, la politique n’existerait tout simplement pas. Or, le désir de dominer, parfaitement naturel et donc inévitable, structure toute collectivité et la divise en trois : ceux qui veulent dominer (les Grands), ceux qui accepteraient cette domination par nécessité de survie (la populace, la plèbe) et ceux qui ne veulent ni l’un ni l’autre (le peuple, la « classe moyenne »). Ce point de départ, le système politique républicain l’assume. Il accepte l’inégalité fondamentale des conditions et des désirs, dans sa tripartition même.
Dès lors, Machiavel place au centre du dispositif à la fois la loi, que chacun doit avant tout respecter, mais aussi les armes. Le Florentin n’imagine pas une seconde que les Grands arrêteront d’eux-mêmes leur soif de domination et de reconnaissance. Il anticipe ainsi les libéraux, en particulier Montesquieu sur ce point, en estimant que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Dans la vision machiavélienne et pragmatique des choses, l’arrêt d’une domination qui risquerait d’être tyrannique ne peut se faire par la Loi seule. Il convient que le peuple de citoyens soit armé pour imposer le respect de la Loi aux Grands.
Pour le Florentin, cette dynamique initiale ne débouche pas sur la guerre civile mais sur l’évolution de la soif de domination des Grands qui vont, par la force des choses, tourner leurs désirs vers l’extérieur. Plutôt que tyrans, ils vont avoir un double intérêt à devenir généraux et hommes d’État. Ce point est très visible à travers le plan des Discours sur la première décade de Tite-Live, livre méconnu du grand public mais très lu par les républicains ultérieurs. Pour Machiavel, le système politique républicain, dans ses turbulences et son instabilité fondamentale, offre la possibilité de la puissance à l’extérieur et d’une certaine forme d’impérialisme.
« Si vis pacem… »
Pour Machiavel, toute situation de paix correspond à ce moment qui précède une nouvelle guerre. Par conséquent, il faut préparer la guerre, au mieux pour ne pas avoir à la faire. La vie du Secrétaire se déroula pendant les guerres d’Italie où la guerre était omniprésente et inévitable. De son point de vue, un pacifisme qui pourrait présider à une compétition aux armements pour défendre les démocraties en assumant le risque de guerre est toujours préférable à un désarmement qui ne pourrait qu’augurer d’une invasion à venir.
La question de la paix, pour Machiavel, nous est ainsi restituée comme celle d’une tension très difficile à atteindre et non comme d’un projet idéal rationnel. Ainsi, l’effort kantien pour promouvoir la paix perpétuelle via une extension de l’État de droit à toutes les entités politiques est à l’opposé de la pensée machiavélienne. Selon le Florentin, pour obtenir la paix, il convient qu’une puissance impériale républicaine soit limitée par une autre puissance impériale équivalente. Nous pourrions dire que, dans notre monde contemporain, ce fut le cas en Europe depuis 1945, sous la domination de la puissance impériale américaine face à l’URSS. Dès lors que la première puissance n’est plus, il convient de lui substituer une puissance suffisante pour dissuader toute agression extérieure.
Mourir pour la liberté ?
Machiavel lierait sans doute cette question à une autre, plus essentielle pour lui et qui fonderait sans doute, à ses yeux, l’ensemble du problème démocratique : sommes-nous prêts à mourir pour la liberté, c’est-à-dire pour ce qui la permet, à savoir la patrie et son régime politique ?
Cette question simple et cruciale, pour Machiavel, ne devrait jamais sortir de l’horizon d’une société qui souhaite perdurer. La liberté, pour Machiavel, c’est la puissance : seul un peuple en armes est libre et capable de maintenir sa liberté face aux Grands comme face à l’ambition des voisins, en imposant la crainte.
Nombre de voix se font entendre, aujourd’hui, sur le caractère sacré de la vie. Dans une perspective machiavélienne, qui retrouve les pensées philosophiques antiques préchrétiennes, en particulier stoïcienne, la vie ne saurait être sacrée. Elle n’est pas le don ineffable du Créateur, mais un fait qui nous projette dans un univers collectif au sein duquel nous devons faire des choix et apporter un sens qui n’est pas donné d’avance et qui n’est pas extérieur à ce monde. Il y a ici tout un questionnement à approfondir, un sens à donner au politique dans nos sociétés, à la fois christianisées et désenchantées, pour reprendre le terme de Max Weber.
Machiavel apporte une réponse républicaine sans aucune ambiguïté, impliquant une réponse radicale à la question de savoir si nous voulons vivre à tout prix, y compris sous une tyrannie. Ce premier penseur de la modernité écartait clairement toute perspective chrétienne pour privilégier, d’une manière très singulière à son époque, une « religion civique » sur le modèle romain pré-chrétien. La réflexion que suscite la lecture de Machiavel pour nos démocraties libérales, renvoie à la place de la politique dans nos vies. Pour le Florentin, la vie ne vaut que si elle est politiquement libre.
Jérôme Roudier est l’auteur de Machiavel par lui-même (PUF, 2025).
![]()
Jérôme Roudier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Auteur : Jérôme Roudier, Professeur de philosophie politique, Institut catholique de Lille (ICL)
Aller à la source