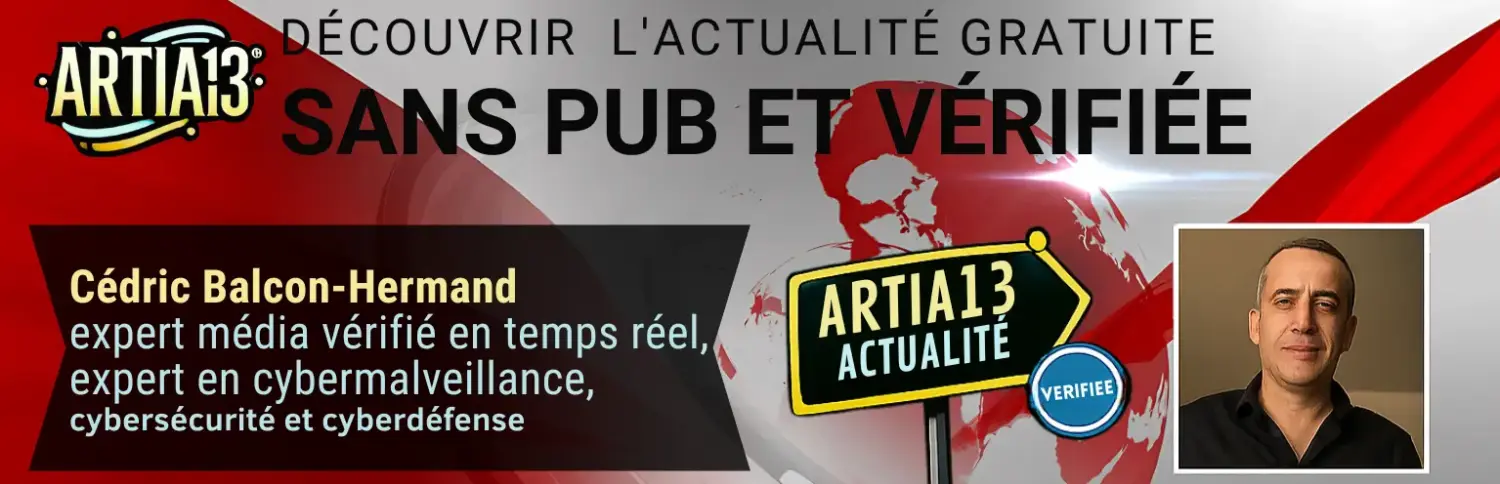Le rejet brutal par Donald Trump des théories du complot autour de Jeffrey Epstein provoque une onde de choc chez ses partisans les plus fidèles, qu’il n’hésite plus à traiter de « stupides » ou de « crédules ». Un tournant risqué à quelques mois de la présidentielle.
Pendant sa campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2024, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il allait déclassifier et rendre publics les dossiers liés à Jeffrey Epstein, le financier déchu mort en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel.
Les soi-disant dossiers Epstein contiendraient, pense-t-on, des contacts, des communications, et – peut-être plus crucial encore – les registres de vol. L’avion privé d’Epstein étaient en effet le moyen de transport utilisé pour se rendre sur ce qui a ensuite été surnommé « l’île pédophile », où lui-même et ses associés auraient fait venir et abusé des mineurs.
Les partisans de Trump les plus enclins aux théories du complot – dont beaucoup pensent qu’Epstein a été assassiné par de puissantes figures pour dissimuler leur implication dans ses crimes sexuels – espèrent que ces dossiers révéleront l’identité de l’élite présumée impliquée dans l’exploitation sexuelle d’enfants.
Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Chaque lundi, recevez gratuitement des informations utiles pour votre carrière et tout ce qui concerne la vie de l’entreprise (stratégie, RH marketing, finance…).
Pendant sa campagne, Trump a laissé entendre que les dossiers Epstein mettraient en cause des personnes puissantes – suggérant qu’il connaissait leur identité et leurs actes. Cela constituait à la fois un avertissement lancé à ces individus et un moyen de galvaniser sa base « Make America Great Again » (MAGA). Cela validait également une partie de la théorie du complot QAnon, selon laquelle un « État profond » couvrirait un réseau élitiste d’abus sexuels sur enfants.
Mais le ministère de la Justice a récemment annoncé que l’examen des documents n’avait révélé aucune liste de clients politiquement influents et a confirmé qu’Epstein était mort par suicide. Cela réfute deux croyances centrales pour la base électorale de Trump. Pour une large partie du mouvement MAGA, ces conclusions banales ont été vécues comme une trahison.
Musk flaire l’opportunité
L’ancien allié proche de Trump — son bailleur de fonds et conseiller — Elon Musk, a profité de l’affaire des dossiers Epstein pour contre-attaquer sur les réseaux sociaux. Sans apporter de preuves, Musk a insinué à plusieurs reprises que le nom de Trump figurait dans les documents. Trump a répliqué en accusant Musk d’« avoir perdu la tête », en s’appuyant sur des éléments fournis par l’ancien avocat d’Epstein, David Schoen, pour rejeter les accusations de Musk.
Les accusations de Musk pourraient être toxiques pour Trump. Une bonne partie du mouvement Maga croit en la théorie QAnon. Être potentiellement lié à un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants nuirait donc gravement à la réputation de Trump auprès de cette base, pour qui il s’agit d’un sujet extrêmement sensible. Musk a semé le doute chez certains activistes, qui se demandent désormais si Trump ne serait pas impliqué dans une dissimulation.
La base MAGA reste en grande partie fidèle à Trump. Mais cette loyauté a déjà nécessité beaucoup de pragmatisme depuis sa réélection. Une position clé soutenue par ces électeurs – l’opposition de Trump aux interventions militaires étrangères – a été contredite par les effets lorsque le président états-unien a lancé son attaque contre des sites militaires iraniens en juin.
Les porte-parole MAGA ont justifié ces actions en disant qu’elles étaient limitées et répondaient à une provocation exceptionnelle. Elles sont présentées comme un contre-exemple aux engagements militaires prolongés du président George Bush en Afghanistan et en Irak dans les années 2000.
Un autre effort de pragmatisme a été exigé sur le « Big Beautiful Bill Act », qui va creuser la dette nationale de plusieurs milliers de milliards de dollars, tout en réduisant les financements de la santé et de l’aide alimentaire. Ces mesures ont retiré des prestations à une bonne partie des électeurs Maga.
Malgré cette souffrance financière personnelle, les fidèles Maga ont défendu ces décisions comme un moyen de réduire les gaspillages et de mettre l’État au régime. Ils font confiance à Trump, qui affirme qu’ils ne seront pas désavantagés à long terme — bien que les conséquences de l’application de la réforme restent inconnues.
Du sucre de canne dans le Coca
Trump a aussi mis à mal la patience des producteurs de maïs du Midwest, pourtant un de ses bastions électoraux. Il a exigé que Coca-Cola remplace le sirop de maïs par du sucre de canne dans sa version sucrée de la boisson. Trump, avec son ministre de la Santé controversé Robert F. Kennedy Jr., a en effet affirmé que le sucre de canne est plus sain — une affirmation contestée — et qu’il permettrait de « rendre l’Amérique saine à nouveau ».
Même si la question du sucre dans le Coca-Cola peut sembler anecdotique, soutenir une mesure qui nuit aux agriculteurs du Midwest passe mal pour les fidèles MAGA. En devant composer avec ces tensions, certains pourraient commencer à douter de la sagesse de Trump.
Le dossier Epstein, danger politique majeur
Les débats autour des dossiers Epstein pourraient être autrement plus dangereux pour Trump et sa relation avec la base Maga. L’existence d’un réseau pédophile élitiste est centrale dans la théorie conspirationniste QAnon et Trump était censé être celui qui allait révéler la vérité. Mais le ministère de la Justice a désormais rejeté cette vision du monde. Et certains en viennent à se demander si Trump ne fait pas lui-même partie de la dissimulation.
Pire encore, Trump a contre-attaqué. Il a déclaré que la conspiration autour d’Epstein n’avait jamais existé et a qualifié certains de ses partisans de « crétins crédules » pour continuer à y croire. Pour certains fidèles, cela va trop loin. Ils ont exprimé leur frustration sur Truth Social, le réseau de Trump, ainsi que sur des blogs et podcasts de droite.
Démonstration de « whataboutisme »
Trump a depuis tenté d’adoucir ses critiques contre ceux qui croient encore à la théorie Epstein, déclarant qu’il souhaiterait publier toute information crédible. Il est aussi revenu à une tactique de campagne classique : le « whataboutisme », qui souligne le traitement injuste qu’il subirait en comparaison avec ses prédécesseurs Barack Obama et Joe Biden.
L’épisode des dossiers Epstein pourrait passer. Mais la question de savoir si le mouvement Maga est désormais plus grand que Trump restera. Pour un président qui plaisantait autrefois en disant qu’il pourrait « tirer sur quelqu’un sur la Cinquième Avenue sans perdre de soutien », la loyauté et la flexibilité de ses partisans sont capitales.
Le mouvement Maga n’est pas monolithique dans ses croyances ou ses actions. Mais si Trump perd la loyauté d’une partie de ses troupes, ou si ces dernières refusent de s’adapter comme elles l’ont fait jusqu’ici, cela pourrait lui coûter cher politiquement. Depuis la tombe, Epstein pourrait bien avoir amorcé une nouvelle ère dans la politique américaine.
![]()
Robert Dover ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Auteur : Robert Dover, Professor of Intelligence and National Security & Dean of Faculty, University of Hull
Aller à la source