
La forêt pourrait s’étendre bien plus haut sur les flancs des Pyrénées, alors pourquoi ne s’aventure-t-elle pas plus en altitude ? Ce phénomène se manifestait déjà avant que les effets du réchauffement climatique ne se fassent ressentir, l’explication est donc ailleurs.
Vous l’avez peut-être déjà remarqué lors d’une randonnée dans les Alpes ou dans les Pyrénées : en montagne, le climat façonne la répartition de la végétation. Plus on monte en altitude et plus les températures diminuent, plus les forêts deviennent clairsemées, jusqu’à laisser la place aux pelouses alpines. Ce schéma classique se retrouve des Andes aux Alpes. Pourtant, dans les Pyrénées orientales, la réalité du terrain raconte une tout autre histoire : la forêt s’arrête bien en dessous de la limite que le climat seul devrait imposer.
La limite supérieure de la forêt, sentinelle du climat ?
La limite supérieure de la forêt marque une transition entre la forêt fermée de l’étage subalpin et la pelouse de l’étage alpin. Elle correspond à ce que les scientifiques appellent un « écotone » : une zone de transition entre deux milieux.
Longtemps, cette discontinuité paysagère a été considérée comme le reflet naturel des contraintes climatiques, principalement le froid et la durée de la saison de croissance des arbres avec des vitesses de croissance qui varient selon les espèces.

Déborah Birre/Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Fourni par l’auteur
Ce sujet n’est pas nouveau. Depuis plus de deux siècles, des scientifiques de toutes disciplines se sont intéressés à cet écotone. Au début du XIXe siècle, Alexander von Humboldt gravit le Chimborazo, un volcan de l’actuel Équateur, et y observe des changements graduels de la flore en altitude : la végétation s’y organise en bandes successives contrôlées par la température décroissante. Ces observations ont jeté les bases du modèle classique de l’étagement de la végétation. Un modèle qui, depuis, s’est longuement imposé avant d’être largement nuancé par les récentes recherches.
Les Pyrénées : un laboratoire grandeur nature
Les Pyrénées défient cependant ce paradigme. Ici, comme ailleurs en Europe, la limite supérieure de la forêt est située à une altitude bien plus basse (environ 1 900 mètres en moyenne dans la partie orientale des Pyrénées) que ce que les températures leur permettraient d’atteindre en théorie (environ 2 500 mètres d’altitude). La hausse actuelle des températures, liée au réchauffement climatique, n’entraîne pas non plus une progression systématique de cette limite.
Pour comprendre pourquoi, des chercheurs du programme SpatialTreeP ont mené une enquête d’envergure. Nous avons cartographié et comparé l’évolution de cet écotone sur 626 sites des Pyrénées ariégeoises et orientales entre 1955 et 2015 à partir de photographies aériennes.
Nous avons analysé plus de 90 variables caractérisant l’environnement de ces sites, allant du climat à la topographie, en passant par la géologie et les traces d’activités humaines. L’objectif était d’identifier les facteurs influençant la dynamique des lisières forestières et de détecter des profils de sites présentant des caractéristiques environnementales similaires.
Trois types de paysages forestiers dans les Pyrénées
Nos résultats révèlent une grande hétérogénéité dans l’évolution des forêts pyrénéennes au cours des soixante dernières années. Trois grands types de paysages et de dynamiques se dégagent.
Dans certains secteurs, la forêt progresse rapidement, gagnant plusieurs centaines de mètres en altitude sur soixante ans. Ailleurs, elle se densifie sans s’étendre, les arbres remplissant progressivement les clairières et espaces ouverts. Sur d’autres sites encore, la limite forestière reste figée voire recule.
Pourquoi de telles différences ? Parce que d’autres facteurs viennent interférer avec les conditions climatiques. Il est donc illusoire de chercher un unique coupable. La dynamique de limite forestière résulte d’une combinaison complexe et imbriquée de facteurs.
L’empreinte humaine : un héritage qui perdure
Les Pyrénées sont des montagnes profondément anthropisées, et ce depuis longtemps.
Pendant des siècles, les pratiques agropastorales (pâturage, défrichement, coupe de bois et reboisements) et l’exploitation du charbon de bois ont profondément façonné les paysages montagnards. Dans les zones les plus exploitées, la limite forestière a été largement abaissée, laissant place à des pâturages et à des landes dès l’étage montagnard.
Dans les zones pastorales actuelles, les milieux d’estives sont volontairement et activement laissés à l’état de prairie, empêchant toute colonisation forestière. À l’inverse, l’abandon progressif de ces pratiques, depuis le milieu du XXe siècle, a permis à la forêt de reconquérir les terrains délaissés, en particulier dans le département des Pyrénées-Orientales. L’abandon y a eu lieu plus tôt qu’en Ariège, ce qui explique que la limite forestière y atteigne des altitudes plus élevées.
Cette pression humaine, par son intensité variable selon les secteurs et les périodes, explique en grande partie pourquoi la position de l’écotone ne suit pas mécaniquement l’évolution du climat. Là où la pression humaine a diminué et où les conditions climatiques restent favorables, la forêt s’étend et rattrape progressivement l’écart avec son altitude maximum théorique.
Le terrain façonne aussi la forêt
D’autres variables liées au milieu conditionnent aussi le niveau de la forêt. L’exposition au vent et l’humidité des sols favorisent, par exemple, la densification des forêts au niveau de l’écotone. À l’inverse, la progression forestière est ralentie dans les zones où le relief est doux et donc plus favorable au maintien de l’activité agropastorale.
La composition des peuplements forestiers joue aussi un rôle. Les conifères comme les pins à crochets, mieux adaptés aux conditions rudes d’altitude, sont associés à des limites plus diffuses où arbres isolés et bosquets clairsemés s’échelonnent jusqu’à la pelouse alpine. Les feuillus comme les hêtres sont davantage associés à des limites plus nettes, avec une rupture paysagère marquée.
La nature du substrat a également une influence : les dépôts sédimentaires récents (dits quaternaires) et les roches cristallines (comme le granite ou le gneiss) favorisent des écotones plus diffus, caractérisés par des arbres épars. Cela pourrait s’expliquer par des sols plus pauvres et moins profonds, qui freinent la fermeture du couvert forestier.
Le réchauffement climatique : accélérateur de dynamiques déjà en cours
À l’échelle régionale, les variations climatiques n’expliquent pas ou peu les différences observées entre les sites. Elles jouent cependant probablement un rôle d’accélérateur des dynamiques, en facilitant l’établissement des arbres là où les conditions locales sont favorables. En ce sens, les dynamiques actuelles traduisent davantage une réponse à des conditions locales qu’un signal direct du réchauffement climatique.
En définitive, la limite supérieure de la forêt dans les Pyrénées ne se comprend qu’au travers de l’analyse des interactions complexes entre conditions environnementales et héritages des pratiques humaines.
Les recherches montrent qu’il n’existe pas un unique facteur et que, dans des milieux très transformés par l’être humain, comme c’est le cas dans ce massif, les effets du climat peuvent être localement dissimulés derrière les impacts humains. Chaque écotone porte ainsi l’héritage de son histoire et de ses particularités locales.
![]()
Déborah Birre a reçu des financements de l’Université Sorbonne Paris Nord dans le cadre d’un contrat doctoral.
Ces recherches ont été menées dans le cadre du programme SpatialTreeP, financé par l’agence nationale de la recherche (ANR-21-CE03-0002).
Auteur : Déborah Birre, Docteure en géographie, Fondation pour la recherche sur la biodiversité
Aller à la source
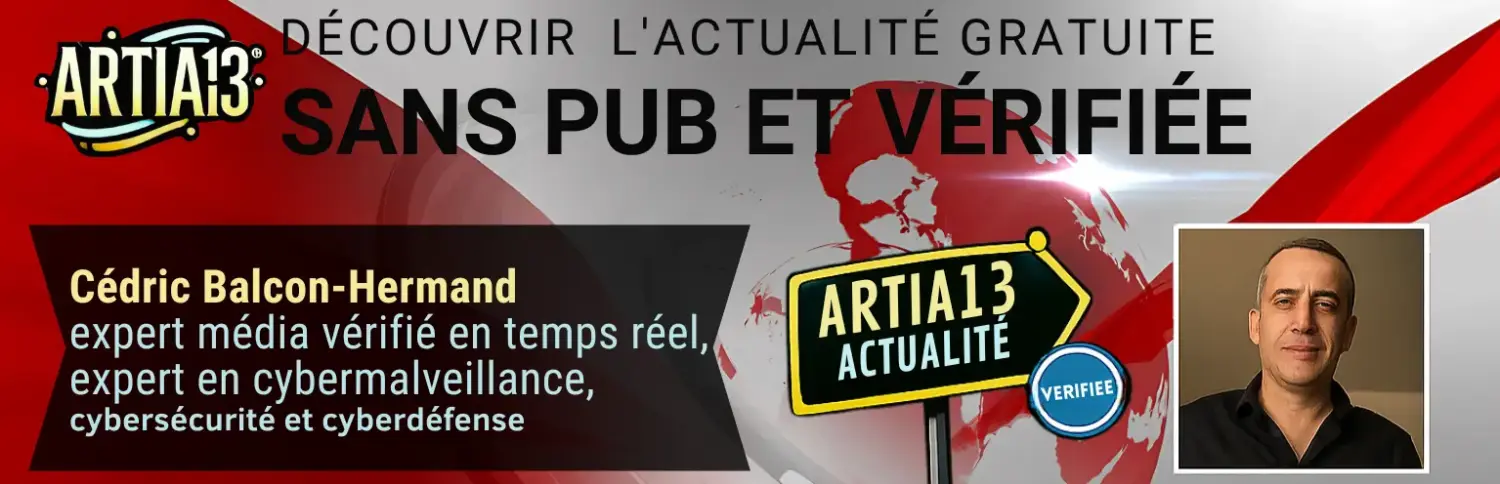



![Sacha Breyer et la vulgarisation scientifique [L’objet de la Recherche #17] Sacha Breyer et la vulgarisation scientifique [L’objet de la Recherche #17]](https://www.artia13.tech/wp-content/uploads/2025/07/Sacha-Breyer-et-la-vulgarisation-scientifique-Lobjet-de-la-Recherche-390x205.webp)