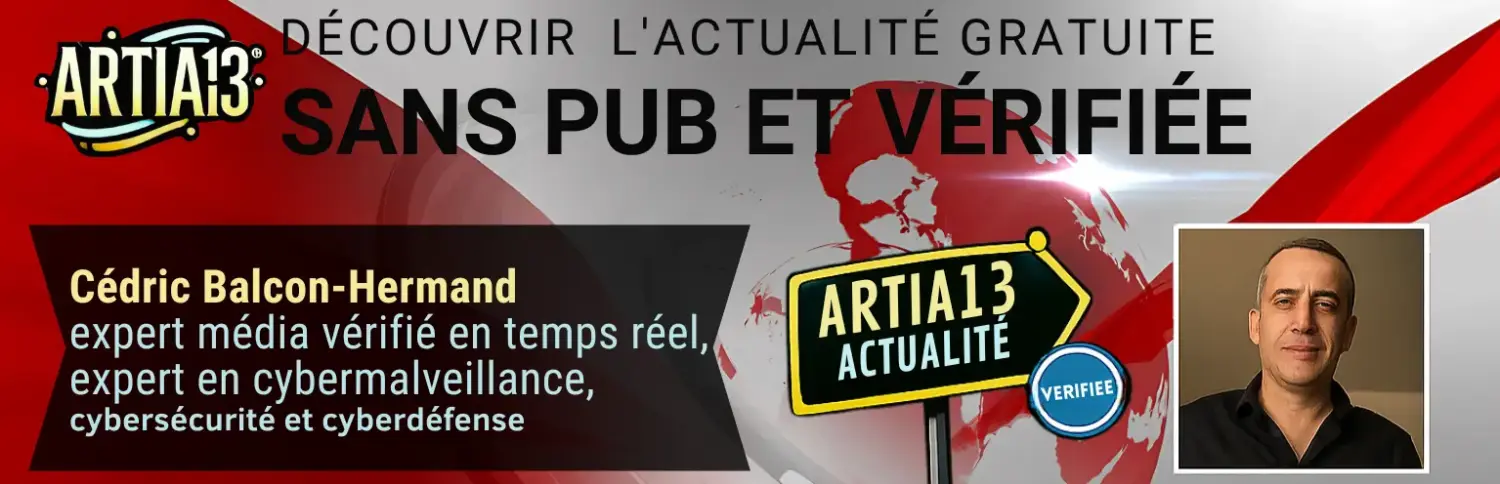Alors qu’on ne le trouve que dans une unique vallée au Maroc, le cyprès de l’Atlas est aujourd’hui menacé par l’exploitation humaine et a été durement touché par le séisme qui a frappé le Maroc en septembre 2023. Pourtant, cette espèce, protégée et plantée dans d’autres régions, résiste particulièrement bien au réchauffement climatique.
Le bassin méditerranéen est l’un des 36 points chauds de biodiversité d’importance mondiale en raison de sa grande biodiversité, souvent propre à la région. Il est en effet riche de plus de 300 espèces d’arbres et d’arbustes contre seulement 135 pour l’Europe non méditerranéenne. Parmi ces espèces, un certain nombre sont endémiques, comme le genévrier thurifère, le chêne-liège, plusieurs espèces de sapins mais aussi le remarquable cyprès de l’Atlas.
Décrit dès les années 1920, ce cyprès cantonné dans une seule vallée du Haut Atlas, au Maroc, a intéressé nombre de botanistes, forestiers et écologues, qui ont étudié cette espèce très menacée, mais aussi potentielle réponse au changement climatique.
Un arbre singulier et endémique de sa vallée
Le premier à faire mention en 1921 de la présence de ce cyprès dans la vallée de l’oued N’Fiss, dans le Haut Atlas, est le capitaine Charles Watier, inspecteur des eaux et forêts du Sud marocain. Mais c’est en 1950 que Henri Gaussen, botaniste français, qualifie ce conifère de cyprès des Goundafa, l’élève au rang d’espèce et lui donne le nom scientifique de Cupressus atlantica Gaussen.
C’est à l’occasion de son voyage au Maroc en 1948 qu’il a constaté que cet arbre, dont la localisation est très éloignée de celles des autres cyprès méditerranéens, est bien une espèce distincte. En particulier, son feuillage arbore une teinte bleutée et ses cônes, que l’on appelle familièrement des pommes de pin, sont sphériques et petits (entre 18 et 22 mm) alors que ceux du cyprès commun (Cupressus sempervirens), introduit au Maroc, sont beaucoup plus gros (souvent 3,5 cm) et ovoïdes.
Le cyprès de l’Atlas se développe presque uniquement au niveau de la haute vallée du N’Fiss, région caractérisée par un climat lumineux et très contrasté.

Thierry Gauquelin/Aix Marseille Université, Fourni par l’auteur
On a aujourd’hui une bonne estimation de la superficie couverte par cette espèce dans la vallée du N’Fiss, qui abrite donc la population la plus importante de cyprès de l’Atlas. : environ 2 180 hectares, dont environ 70 % couverts de bosquets à faible densité. Dans les années 1940 et 1950, elle était estimée entre 5 000 et 10 000 hectares. En moins de cent ans, on aurait ainsi perdu de 50 à 80 % de sa surface ! Malgré les imprécisions, ces chiffres sont significatifs d’une régression importante de la population.
Des cyprès aux formes très diverses
Dans ces espaces boisés, la densité des arbres est faible et l’on peut circuler aisément entre eux. Les couronnes des arbres ne se rejoignent jamais et, hormis sous celles-ci, le soleil frappe partout le sol nu.
L’originalité de cette formation est que cohabitent aujourd’hui dans cette vallée de magnifiques cyprès multiséculaires aux troncs tourmentés, des arbres plus jeunes, élancés et en flèche pouvant atteindre plus de 20 mètres de hauteur et des arbres morts dont ne subsistent que les troncs imputrescibles. Ce qui est frappant, et que signalait déjà le botaniste Louis Emberger en 1938 dans son fameux petit livre les Arbres du Maroc et comment les reconnaître, c’est que la majorité des arbres « acquièrent une forme de candélabre, suite à l’amputation de la flèche et à l’accroissement des branches latérales ».

Thierry Gauquelin/Aix Marseille Université, Fourni par l’auteur
Une pression humaine ancienne et toujours forte
L’allure particulière de ces arbres et la proportion importante d’arbres morts sont avant tout à imputer à l’être humain qui, depuis des siècles, utilise le bois de cyprès pour la construction des habitations et pour le chauffage. Il coupe aussi le feuillage pour nourrir les troupeaux de chèvres qui parcourent la forêt.
En plus de ces mutilations, les arbres rencontrent des difficultés pour se régénérer, en lien avec le surpâturage, toutes les jeunes régénérations des arbres étant systématiquement broutées. La pression anthropique est ainsi une composante fondamentale des paysages de forêt claire de cyprès de l’Atlas.

Thierry Gauquelin/Aix Marseille Université, Fourni par l’auteur
Cette dégradation des arbres et la régression de la population de cyprès ne sont sans doute pas récentes. La vallée du N’Fiss est le berceau des Almohades, l’une des plus importantes dynasties du Maroc, qui s’est étendue du Maghreb à l’Andalousie, du XIIe au XIIIe siècle. La mosquée de Tinmel, joyau de l’art des Almohades, s’imposait au fond de cette vallée, témoin de la fondation de cette grande dynastie. Et il est fort à parier que c’est du bois local, donc de cyprès, qui a été utilisé à l’origine pour la toiture de cette monumentale construction.
Pourquoi aller chercher bien loin du cèdre, comme certains historiens l’ont suggéré, alors qu’une ressource de qualité, solide et durable, existait localement ? L’étude anatomique de fragments de poutres retrouvées sur le site devrait permettre de confirmer cette hypothèse, les spécialistes différencient facilement le bois de cyprès de celui des autres essences de conifères. Dans tous les cas, il est certain que lors de cette période, le cyprès a subi une forte pression, du fait de l’importance de la cité qui entourait ce site religieux.
On notera enfin, confortant les relations intimes entre le cyprès et les populations locales, les utilisations en médecine traditionnelle : massages du dos avec des feuilles imbibées d’eau ou encore décoction des cônes employée comme antidiarrhéique et antihémorragique.
Le séisme du 8 septembre 2023
Le 8 septembre 2023, le Maroc connaît le séisme le plus intense jamais enregistré dans ce pays par les sismologues. Les peuplements de cyprès se situent autour de l’épicentre du séisme. Ce dernier affecte la vallée du N’Fiss et cause d’importants dégâts matériels, détruisant des habitations et des villages et causant surtout le décès de près de 3 000 personnes. Le séisme a également endommagé le patrimoine architectural, et notamment la mosquée de Tinmel, presque entièrement détruite, qui fait, depuis, l’objet de programme de restauration.
Malgré son intensité (6,8), le séisme ne semble pas avoir eu d’effets directs sur les cyprès par déchaussements ou par glissements de terrain, bien que cela soit difficile à apprécier. Ceux-ci ont néanmoins subi des dégâts collatéraux.
Lors du réaménagement de la route principale, des arbres ont été abattus, notamment un des vieux cyprès (plus de 600 ans) qui avait pu être daté par le Pr Mohamed Alifriqui, de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. De plus, des pistes et des dépôts de gravats ont été implantés au sein même des peuplements, à la suite d’une reconstruction rapide, et évidemment légitime, des villages. Cela a cependant maltraité, voire tué, de très vieux cyprès.

Thierry Gauquelin/Aix Marseille Université, Fourni par l’auteur
Protéger une espèce en danger critique d’extinction
Malgré la distribution restreinte de l’espèce et l’importante dégradation qu’elle subit, une forte diversité génétique existe encore dans cette population. Cependant, il existe un risque important de consanguinité et de perte future de biodiversité au sein de cette vallée. Ainsi, C. atlantica est classé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) parmi les 17 espèces forestières mondiales dont le patrimoine génétique s’appauvrit.
Une autre menace est celle du changement climatique qui affecte particulièrement le Maroc et ses essences forestières. Les six années de sécheresse intense que cette région du Maroc a subies n’ont sans doute pas amélioré la situation, même si l’impact sur les cyprès semble moins important que sur les chênes verts, sur les thuyas ou sur les genévriers qui montrent un dépérissement spectaculaire.
Pour toutes ces raisons, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé le cyprès de l’Atlas comme étant en danger critique d’extinction. Il faut alors envisager des stratégies à grande échelle afin d’assurer la survie voire la régénération des forêts de cyprès. Cela passe à la fois par la fermeture de certains espaces, afin d’y supprimer le pâturage, et par l’interdiction des prélèvements de bois.
Tout ceci ne sera cependant possible qu’en prévoyant des mesures compensatoires pour les populations locales.
Replanter dans la vallée, mais aussi dans le reste de la région
Il est aussi nécessaire de replanter des cyprès, ce qui nécessite la production de plants de qualité, même si les tentatives menées par le Service forestier marocain ont pour le moment obtenu un faible taux de réussite.
Le cyprès de l’Atlas, adapté à des conditions de forte aridité, pourrait d’ailleurs constituer une essence d’avenir pour le Maroc et pour le Maghreb dans son ensemble face au changement climatique. Dans le bassin méditerranéen, le réchauffement provoque en effet une aridification croissante et notamment une augmentation de la période de sécheresse estivale. Henri Gaussen disait déjà en 1952 :
« Je crois que ce cyprès est appelé à rendre de grands services dans les reboisements de pays secs. »
Et pourquoi ne pas penser au cyprès de l’Atlas pour les forêts urbaines ? Un bon moyen de préserver, hors de son aire naturelle, cette espèce menacée.
Conservation, reboisements et utilisation raisonnée nécessitent ainsi des investissements financiers importants. Richard Branson, le célèbre entrepreneur britannique, s’est particulièrement investi dans le développement de la vallée du N’Fiss et est notamment venu au secours de ses habitants à la suite du séisme meurtrier d’il y a deux ans. Si son but est d’améliorer la vie et le futur des habitants de la vallée, espérons qu’il saura aussi s’intéresser à cet écosystème particulier, et que d’autres fonds viendront soutenir les efforts de conservation.
![]()
Thierry Gauquelin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Auteur : Thierry Gauquelin, Professeur émérite, Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU)
Aller à la source