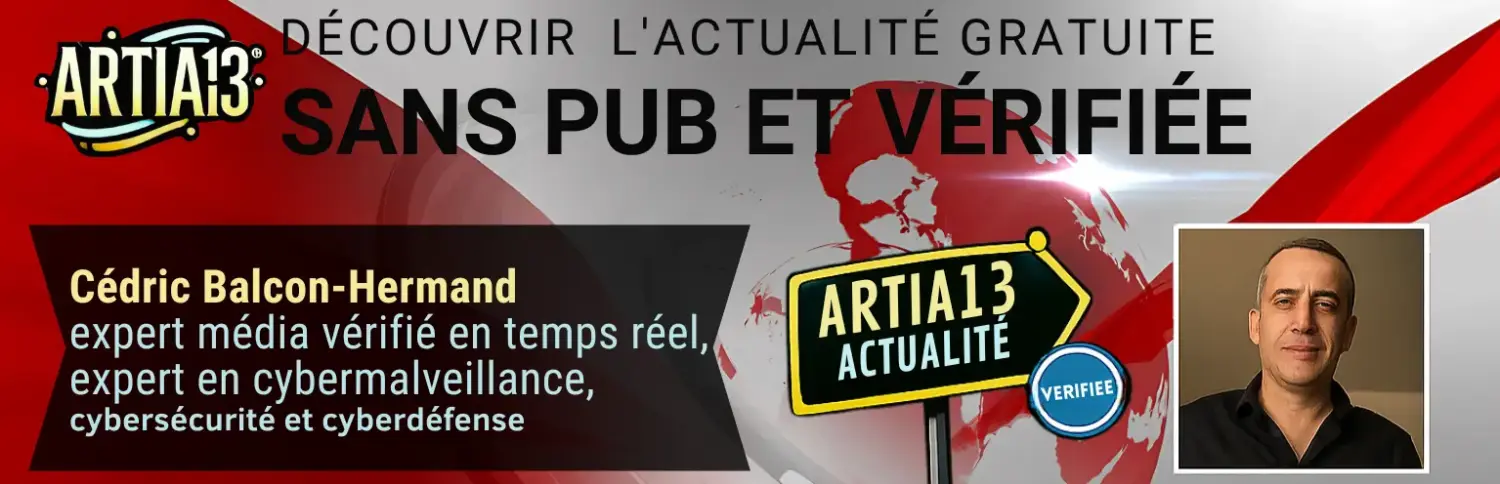Ils comptaient déjà faire revivre le mammouth laineux et le loup sinistre, voilà que l’entreprise états-unienne Colossal Biosciences se lance dans un nouveau projet de « désextinction » avec un oiseau géant, le moa, disparu il y a environ six cents ans. Ces projets posent de très nombreuses questions.
Dans un contexte où l’innovation biotechnologique et les politiques économiques semblent suivre des trajectoires divergentes, les États-Unis se trouvent à un tournant. Ces dernières semaines ont révélé un contraste marquant entre l’annonce de la mise au monde d’un jumeau génétique d’une espèce disparue et la volonté de remettre au monde un oiseau géant disparu depuis des siècles, la création d’une espèce inventée (une chimère) dans la perspective de déséteindre le mammouth et une instabilité financière importante, perpétuellement renouvelée par les discours et orientations économiques controversées de l’administration Trump.
Cette concomitance met en exergue des questions fondamentales sur l’éthique de l’innovation et sa viabilité dans un environnement économique rendu volontairement imprévisible.
La « résurrection » du loup sinistre dans une économie instable
Colossal Biosciences a attiré l’attention, il y a peu, en mettant au monde une créature ayant une structure génétique similaire à celle du loup sinistre (Canis dirus), prédateur géant disparu il y a 13 000 ans. Le processus mobilise extraction et reconstruction d’ADN ancien, puis édition génomique d’embryons actuels de loups, perpétuant l’élan donné par le séquençage du premier génome d’espèce éteinte en 2008.
Parallèlement, l’économie américaine traverse une période de turbulences sans précédent, rappelant les politiques mercantilistes où la richesse se mesurait à l’accumulation de métaux précieux et au protectionnisme. Les dernières semaines ont été marquées par le vote d’un texte qui met dette et déficits américains sur des trajectoires inquiétantes, une succession d’aller-retours vertigineux sur les droits de douane suspendus et réduits le 10 avril à 10 % pour 90 jours face à l’affolement des marchés financiers, mais pour finalement être – s’agissant de certains produits – réinstaurés le 4 juin et pour d’autres, reportés au 1er juillet et, enfin dernièrement, au 1er août.
Cette instabilité s’est amplifiée avec la dégradation historique de la note de la dette américaine par Moody’s de Aaa à Aa1 le 16 mai, la dernière agence à retirer son triple A au pays, justifiant sa décision par une dette de près de 36 000 milliards de dollars et la nécessité à très court terme de refinancer plus de 9 200 milliards de dollars. Même si les doutes sur la réalité de la mise en place de ces droits de douane prohibitifs ont calmé le jeu, la moindre étincelle relance le processus : les indicateurs de volatilité témoignent encore de cette nervosité extrême : l’indice VIX qui mesure la « peur » des marchés financiers face à une conjoncture donnée, a dépassé 60 points en avril 2025 avant de redescendre, la plus forte volatilité enregistrée depuis la pandémie de 2020, avec des pics à 45,30 points en « zone de panique » selon les analystes.
Aussi, les pratiques actuelles de renégociation commerciale et de menaces tarifaires réactivent une vision que la théorie économique moderne considère comme obsolète depuis Ricardo, pénalisant notamment les entreprises biotechnologiques, fortement dépendantes d’investissements à long terme et de financements stables.
Tous les quinze jours, de grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !
Des défis éthiques et économiques
Un premier enjeu est l’impact de l’incertitude économique sur l’innovation biotechnologique. Les projets comme celui du loup sinistre ou du moa sont vulnérables : qu’adviendrait-il si les financements s’arrêtaient brusquement ? Contrairement aux essais cliniques, il n’existe pas de protocoles de gestion pour l’arrêt prématuré d’un projet de désextinction : euthanasie, vente douteuse, voire lâcher incontrôlé ne relèvent pas de la science-fiction, d’autant plus lorsque des espèces n’ayant pas d’existence historique sont concernées.
Les implications écologiques sont incalculables, l’ADN seul ne garantissant ni comportement ni adaptation harmonieuse d’un prédateur disparu depuis des millénaires à des écosystèmes profondément modifiés.
Pour une éthique des espèces chimériques ?
Au-delà des questions de viabilité économique, la stratégie adoptée pour ressusciter le loup sinistre ou le mammouth laineux soulève des interrogations éthiques inédites. Le processus implique nécessairement la création d’organismes intermédiaires : des « espèces tests » n’ayant jamais existé dans l’histoire du vivant à l’image de la souris laineuse récemment dévoilée.
Ces créatures chimériques, fruits d’une ingénierie génétique expérimentale, posent la question fondamentale de notre droit à créer des formes de vie inédites dans le seul but d’en parfaire d’autres. L’instabilité scientifique actuelle aux États-Unis – véritable « guerre contre la science » – aggrave cette problématique : la pression exercée sur les chercheurs pour obtenir des résultats rapides et spectaculaires, combinée à l’incertitude des financements, pourrait conduire à multiplier ces expérimentations sur des « organismes prototypes » sans garantie de leur bien-être ni de leur devenir à long terme.
Dans un environnement où les projets peuvent être brutalement interrompus pour des raisons politiques ou économiques, que devient la responsabilité morale envers ces êtres créés uniquement comme étapes vers un objectif hypothétique ? Cette dérive instrumentalise le vivant au service d’une promesse technologique, dont la réalisation demeure incertaine, soulevant des questions déontologiques qui dépassent largement le cadre de la recherche scientifique traditionnelle.
Une deuxième question touche à notre rapport à la biodiversité. La désextinction, réponse séduisante à la crise écologique actuelle, pourrait créer un « biais d’optimisme technologique » et détourner des efforts classiques de préservation des espèces et des habitats. De plus, les choix d’espèces à ressusciter paraissent guidés par une sorte de « prestige culturel » de candidats considérés (mammouth, loup sinistre, moa) plutôt que par des critères écosystémiques, interrogeant sur la finalité réelle de ces projets : restauration écologique ou satisfaction de l’ego ou de la curiosité humaine ?
Enfin, la question de la compatibilité entre innovation de rupture et instabilité institutionnelle se pose. Schumpeter, qui voyait dans la « destruction créatrice » un moteur de changement, insistait aussi sur la nécessité d’un socle institutionnel solide. Or, la volatilité politique et économique aux États-Unis fragilise ce socle. Les avancées biotechnologiques exigent des régulations prévisibles, un système fiable de propriété intellectuelle, des financements pérennes et une capacité à identifier des marchés, conditions aujourd’hui menacées outre-Atlantique. Les entreprises du secteur des biotechnologies doivent alors adapter leurs stratégies au détriment de la continuité scientifique.
Vers un nouveau foyer de l’innovation biotech ?
Dans ce contexte, l’Union européenne se profile comme une alternative solide, avec un marché unique, un cadre réglementaire stable, et des politiques de financement intégrées autour de l’excellence scientifique et de l’impact sociétal (cf. Horizon Europe). L’engagement politique en faveur de la biodiversité y représente un atout, de même que le recours actif au principe de précaution et le soutien public « à la recherche et à l’innovation responsables (RRI) ». Cela permet une anticipation des impacts sociaux et environnementaux et une implication des acteurs concernés, particulièrement crucial pour les technologies controversées.
La réglementation européenne, récemment renforcée sur la biosécurité, ménage une voie prudente, entre le laisser-faire américain et des interdictions pures et simples, et s’appuie sur un dialogue entre science, politique et société civile, propice à l’élaboration de normes éthiques partagées. L’écosystème du financement, mêlant fonds publics, capital-risque et crowdfunding, réduit la vulnérabilité aux cycles économiques et favorise la viabilité à long terme des innovations.
Dans ce contexte, le récent vote de la loi Duplomb en France semble constituer un message incompréhensible et une erreur économique qui recrée l’instabilité institutionnelle là où elle avait disparu. En réintroduisant des pesticides interdits depuis 2018 et en assouplissant les garde-fous environnementaux, cette législation génère une volatilité réglementaire préjudiciable aux biotechnologies. Les secteurs innovants perçoivent ces revirements comme des signaux d’imprévisibilité institutionnelle compromettant l’attractivité des territoires concernés.
Cette incohérence normative menace l’image de la France comme territoire d’accueil stable pour les innovations technologiques, particulièrement dans l’agriculture de précision où la cohérence réglementaire conditionne les investissements R&D. L’adoption controversée de ce texte, contre tous les avis scientifiques, illustre la façon dont l’incohérence politique pourrait transformer un avantage concurrentiel européen en handicap économique.
La coexistence inquiétante du loup sinistre « ressuscité » et d’une économie américaine déstabilisée par ses propres choix illustre bien nombre de dilemmes contemporains. Dans ce contexte, l’innovation biotechnologique se distingue, car elle ne requiert pas seulement des prouesses techniques, mais aussi un environnement stable et un cadre éthique rigoureux.
Les technologies de désextinction, fascinantes mais problématiques, posent des questions essentielles sur notre rapport à la nature, sur la responsabilité intergénérationnelle et sur l’orientation du progrès.
Alors que les États-Unis semblent s’éloigner d’une innovation responsable, l’Europe pourrait s’imposer comme le nouveau berceau de ces avancées, si tant est que les pays membres ne sombrent pas eux-mêmes dans l’incohérence réglementaire. Mais où que se développe l’innovation, le débat éthique que suscite la désextinction nécessite une réflexion collective et transnationale, dépassant les logiques de marché et les frontières géopolitiques.
![]()
Caroline Gans Combe a reçu des financements de l’Union européenne dans le cadre des projets DEFORM et ProRes.
Auteur : Caroline Gans Combe, Associate professor Data, econometrics, ethics, OMNES Education
Aller à la source