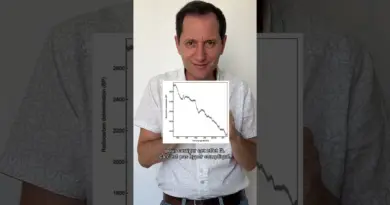Projet d’attentat « incel » déjoué : décrypter le danger masculiniste
Un adolescent a récemment été arrêté en France pour un projet d’attentat inspiré par le masculinisme, relançant l’alerte sur cette mouvance. Né en réaction aux avancées féministes, le masculinisme prétend défendre des hommes présentés comme opprimés et converge de plus en plus vers les idéologies d’extrême droite. Les réseaux sociaux offrent une nouvelle et inquiétante visibilité à cette mouvance, notamment auprès des jeunes hommes.
Le 27 juin 2025, un adolescent de 18 ans a été arrêté dans la région de Saint-Etienne (Loire). Il est soupçonné d’avoir projeté d’attaquer des femmes au couteau.
Le parquet national antiterroriste (PNAT) a, pour la première fois en France, mis un jeune homme en examen pour un projet d’attentat lié aux « incels » (contraction en anglais de « involuntary celibate » – célibataire involontaire – désignant une sous-culture en ligne caractérisée par une haine des féministes, accusées d’entraver leur accès sexuel aux femmes), qui s’inscrit plus largement dans la mouvance masculiniste.
À lire aussi :
‘ Adolescence ‘ est une critique poignante de la masculinité toxique chez les jeunes
Ce n’est un cas ni isolé, ni propre à la France. En 1989, Marc Lépine assassinait 14 femmes à l’École polytechnique de Montréal en dénonçant le féminisme. En 2014, aux États-Unis, Elliot Rodger tuait six personnes, expliquant dans un manifeste sa rancœur envers les femmes qui ne le désiraient pas. Depuis, plusieurs attentats perpétrés par des hommes ont été revendiqués au nom d’une même idéologie : le masculinisme.
Pour les masculinistes, les féministes et les femmes auraient inversé les rapports de domination, les hommes seraient désormais opprimés et il faudrait des mesures pour les protéger. Un récit fondé sur ce que le politologue Francis Dupuis-Déri appelle « le mythe de la crise de la masculinité ».
Le masculinisme : une résistance aux avancées féministes
Ces passages à l’acte sont souvent interprétés comme des dérives psychiatriques. Cette lecture psychologisante obère toutefois la dimension collective et politique du masculinisme qui doit être considéré comme un contre-mouvement social, c’est-à-dire une mobilisation qui se forme en opposition (en réaction) à un mouvement progressiste, ici le féminisme, pour défendre un ordre social hiérarchisé précis.
Le masculinisme s’organise activement – hors ligne et en ligne – contre l’égalité des genres, pour défendre les privilèges masculins mis en cause par les luttes féministes. La sociologue Mélissa Blais le décrit comme un contre-mouvement structuré, enraciné dans l’histoire des résistances aux avancées féministes.
À lire aussi :
Masculinisme : une longue histoire de résistance aux avancées féministes
Bien qu’ancré dans une histoire longue, le masculinisme connaît aujourd’hui une reconfiguration numérique inédite, portée par la circulation transnationale de contenus sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas tant son idéologie qui est nouvelle, que ses formes, ses publics et ses canaux de diffusion.
Les réseaux sociaux ne créent pas cette idéologie, mais ils la rendent plus visible, plus accessible, et surtout plus attractive pour un public jeune en quête d’identité, de repères genrés et de récits explicatifs du monde. Ce nouvel écosystème permet ainsi au masculinisme d’échapper à la marginalité dans laquelle il était autrefois cantonné, pour s’imposer comme une forme contemporaine d’engagement réactionnaire.
Une idéologie qui prolifère dans la « manosphère »
Aujourd’hui, cette idéologie prolifère dans la « manosphère », un ensemble de sous-cultures numériques que l’on retrouve, par exemple, sur des forums comme Reddit (une plate-forme communautaire américaine qui regroupe des milliers de sous-forums thématiques, souvent modérés de façon laxiste), des chaînes YouTube, des serveurs Discord ou des groupes Telegram.
Dans ces espaces circulent des discours haineux, des guides de drague problématiques (valorisant la manipulation et mettant au second plan le consentement) et des appels à ce qui est décrit comme une revanche sexuelle à prendre sur les femmes, à travers, notamment, le viol ou le revenge porn.
La « néo-manosphère », selon certains chercheurs, s’est intensifiée au cours de la dernière décennie en migrant vers des plates-formes peu modérées, en s’adaptant aux codes de l’influence virale et en croisant ses récits avec ceux de l’extrême droite, du suprémacisme blanc ou du complotisme.
Ces contenus visent un public jeune et masculin, en quête de repères virils dans un monde présenté comme féminisé. Ils mobilisent des audiences massives, bien au-delà des marges. En France, des influenceurs masculinistes cumulent des abonnés et semblent connus des plus jeunes (moins de 15 ans) comme l’indiquent des éléments réunis par la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok chez les jeunes.
Le masculinisme converge de plus en plus vers les idéologies d’extrême droite. Cette alliance se construit autour d’un récit commun : celui d’un ordre social menacé par l’égalité, la diversité et la modernité.
Comme le montrent plusieurs études récentes, les discours antiféministes servent souvent de porte d’entrée vers des idées d’extrême droite (racisme, suprémacisme blanc, autoritarisme, opposition à la démocratie). Ainsi, selon ces recherches, près de 30 % des internautes fréquentant des espaces antiféministes migrent ensuite vers des contenus d’extrême droite. D’autres études non seulement confirment ces résultats mais précisent que les personnes exposées à du sexisme en ligne sont 10 % plus susceptibles d’approuver des idées radicales violentes, même si elles ne votent pas à l’extrême droite.
Un contre-mouvement exploité politiquement à l’extrême droite
Le masculinisme est aujourd’hui exploité par des figures d’extrême droite dans les espaces numériques. Thaïs d’Escufon, ex militante de Génération identitaire– groupuscule dissous en mars 2021 par le ministère de l’Intérieur, a par exemple réorienté ses productions numériques vers le masculinisme et vend des formations à destination des jeunes hommes, mêlant conseils de développement personnel, coaching en virilité, revalorisation de rôles genrés traditionnels, critique du féminisme et surtout conseils de drague.
Julien Rochedy, ancien président du Front national de la jeunesse, a également misé sur le masculinisme tout en produisant des discours suprémacistes blancs sur sa chaîne YouTube.
À lire aussi :
Papacito ou comment les youtubeurs d’extrême droite gagnent leurs abonnés
Les discours masculinistes sont aussi investis par certains politiques. Aux États-Unis, Donald Trump a délibérément soutenu des figures de la manosphère comme Andrew Tate ou Jordan Peterson, contribuant à mobiliser une partie de l’électorat masculin.
Ce type de rhétorique se retrouve également ailleurs : au Brésil, avec l’ancien président Jair Bolsonaro, qui a multiplié les déclarations sexistes et homophobes ; en Argentine, avec Javier Milei. Dans ces cas, le masculinisme devient un vecteur de mobilisation politique autour d’une identité masculine perçue comme menacée. Il permet de réactiver des affects de ressentiment en les articulant à une promesse de restauration de l’ordre patriarcal.
Cette convergence est d’autant plus inquiétante qu’elle s’accompagne d’une hausse de la menace terroriste liée à l’ultra droite : en France, en 2021, 29 personnes ont été arrêtées pour des faits de terrorisme liés à l’ultra droite contre 5 en 2020 et 7 en 2019 – le djihadisme demeurant la principale menace. Fin 2023, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin évoquait 13 attentats d’ultra droite déjoués depuis 2017. Aux États-Unis, l’extrême droite est devenu la première cause de mortalité liée aux idéologies extrémistes depuis 2014 : sur les 442 personnes tuées par des extrémistes entre 2014 et 2023, 336 (soit 76 %) l’ont été par des extrémistes de droite.
Ces passages à l’acte s’inscrivent dans des réseaux, récits et références partagés. Comme le rappelle l’Anti-Defamation League, les nouvelles formes d’extrémisme se fondent sur une posture victimaire : des hommes qui se pensent persécutés, trahis par la modernité, autorisés à répondre par la violence.
Identifier le continuum masculiniste
Reconnaître le caractère politique du masculinisme plutôt que le réduire à des problématiques psychologiques individuelles est indispensable pour y répondre. Cela implique une formation plus poussée des magistrats, journalistes et enseignants à ces phénomènes. Cela suppose aussi une meilleure régulation des espaces numériques où ces idées circulent.
Il s’agit d’une part de reconnaître ce qui ne relève pas de l’opinion mais de l’incitation à la haine et d’autre part, de ne pas se focaliser uniquement sur les actes ou prises de position les plus spectaculaires (comme les influenceurs qui jouent volontairement sur l’outrance pour viraliser leurs contenus) et les plus meurtriers.
Si le masculinisme réussit à se répandre c’est aussi parce qu’il s’appuie sur des idées sexistes banalisées et qui sont déjà bien ancrées dans nos sociétés tels que la supposée émotivité et vénalité des femmes ou la meilleure rationalité des hommes.
Ces préjugés sont souvent inculqués dès l’enfance à travers une éducation genrée (deux tiers des femmes déclarent avoir été éduquées différemment des garçons). Cette socialisation différenciée naturalise les inégalités, que les discours masculinistes réactivent ensuite pour justifier la hiérarchie entre les sexes.
![]()
Tristan Boursier a reçu des financements du Fonds de recherche du Québec société et culture (FRQSC).
Auteur : Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po
Aller à la source