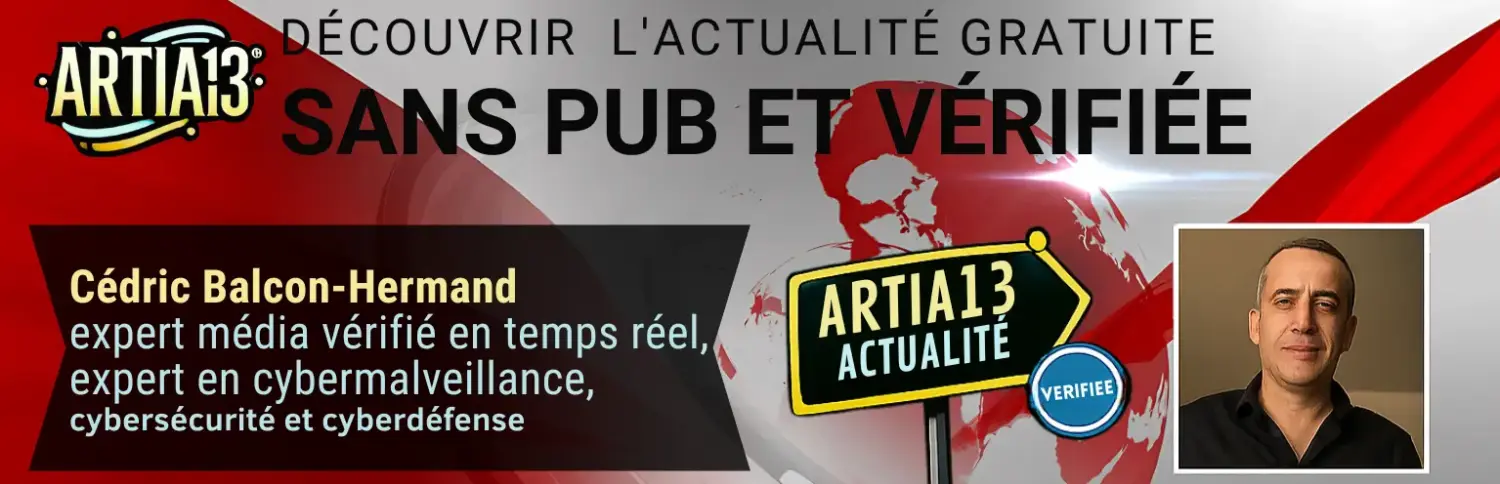Faut-il motiver par la carotte, par le bâton ou par la force du collectif ? Une étude menée en laboratoire teste plusieurs façons de stimuler l’effort en équipe. Si les récompenses financières tirent la performance vers le haut, elles peuvent aussi créer des tensions.
Le travail en équipe est devenu dominant dans les entreprises depuis la fin du XXe siècle, comme l’a rappelé le fondateur de l’économie des ressources humaines, Edward P. Lazear, dans un article cosigné avec Kathryn L. Shaw. Les succès de l’industrie automobile japonaise, pionnière en la matière, ont popularisé ce mode d’organisation. Il accroît l’implication des salariés, stimule l’entraide et le transfert de compétences, offre de la flexibilité face aux aléas de production ou de demande, et améliore la rationalité des décisions des salariés.
Mais il a aussi des inconvénients. Des problèmes de coordination peuvent survenir en l’absence d’un processus de décision clair. Le travail collectif peut également diluer les incitations à l’effort, comme l’avait notamment montré montré Bengt Holmström si les rémunérations dépendent de la performance collective et que le produit des efforts individuels est partagé entre les équipiers.
Plusieurs types de mécanismes incitatifs
Plusieurs mécanismes destinés à prévenir la dilution des incitations au sein des équipes de travail ont été analysés. Il s’agit, soit de mécanismes centralisés et fondés sur un objectif d’équipe ou de la concurrence entre équipes, tels que Haig Nalbantian et Andrew Schotter les ont étudiés, soit de mécanismes décentralisés reposant sur la pression des pairs, c’est-à-dire la désapprobation sociale envers des membres de l’équipe ayant un comportement opportuniste, introduits dans l’analyse économique par Eugene Kandel et Edward P. Lazear.
L’étude de ces mécanismes a fait l’objet de nombreux travaux théoriques et expérimentaux. Mais leur efficacité n’avait pas encore été directement comparée.
C’est l’objet d’une expérience économique réalisée par Marc Lebourges et David Masclet. Les expériences en laboratoire se sont imposées ces dernières décennies comme un outil puissant pour analyser les comportements économiques. En économie, une expérience en laboratoire est une méthode de recherche dans laquelle les comportements économiques sont observés dans un environnement contrôlé (le laboratoire) et les participants sont rémunérés en fonction de leurs décisions. Selon Gary Charness et Peter Kuhn, c’est un outil privilégié pour étudier les incitations en entreprise car elles permettent de contrôler les facteurs mieux que toute autre approche, et sont aussi très flexibles et peu coûteuses.
L’expérience de Marc Lebourges et David Masclet s’inspire d’un jeu d’effort créé par Haig Nalbantian et Andrew Schotter pour modéliser en laboratoire le travail d’équipe en entreprise. Dans ce jeu d’effort, chaque participant décide, en choisissant un nombre, de sa contribution à la production de son équipe. La production de chaque équipe dépend de la somme des contributions de ses membres et détermine leurs revenus. Le gain de chaque participant correspond à la différence entre, d’un côté, sa part du revenu de l’équipe et, d’un autre côté, le coût de l’effort que lui a demandé sa contribution à la production de son équipe, fonction du nombre qu’il a choisi.
Le jeu est répété plusieurs fois et, à la fin de la session expérimentale, chaque participant touche une somme d’argent dépendant des gains qu’il a accumulés durant la session. Dans ce jeu les participants ont intérêt à être opportunistes, c’est-à-dire à ne pas contribuer en espérant que les autres contribuent à leur place. Ces sessions se sont déroulées sur les ordinateurs du laboratoire d’économie de l’Université de Rennes.
À lire aussi :
Entre télétravail et présentiel, quel management post-crise ?
L’expérience compare les niveaux de production et les gains des participants entre un traitement de référence où les revenus sont partagés sans mécanismes d’incitation, un mécanisme de pression des pairs où les coéquipiers peuvent se sanctionner mutuellement et des mécanismes centralisés fondés soit sur un objectif d’équipe, soit sur de la concurrence entre équipes. L’analyse étudie aussi si la nomination de leaders au sein des équipes de travail améliore la coordination de la pression des pairs et diminue son coût social. La possibilité donnée aux leaders de montrer l’exemple à leurs équipiers est enfin évaluée.
En l’absence de mécanismes d’incitation, on observe un niveau d’effort trop faible, quoique dans une moindre mesure que ce que prédit la théorie. La pression des pairs augmente le niveau d’effort, mais celui-ci reste loin de l’optimum. De plus, elle n’améliore pas les gains des participants, car les bénéfices d’une coopération accrue sont compensés par le coût des sanctions mutuelles, pour ceux qui sanctionnent comme pour ceux qui sont sanctionnés.
Les mécanismes centralisés accroissent plus l’effort que la pression des pairs. Les objectifs d’équipe conduisent au plus haut niveau d’effort, mais à des gains faibles pour les participants. Cela s’explique parce qu’une proportion élevée d’équipes n’atteint pas l’objectif, et que leurs membres sont de ce fait pénalisés. Les tournois entre équipes augmentent le niveau d’effort de façon importante, mais sans accroître la moyenne des gains des participants et avec de fortes inégalités entre eux, en raison des transferts entre les équipes gagnantes et perdantes.
L’introduction de leaders d’équipe a un effet positif et durable sur l’effort s’ils peuvent à la fois donner l’exemple et sanctionner leurs équipiers, et cela même lorsqu’ils sont choisis au hasard. Mais un leader d’équipe choisi au hasard a un effet négatif sur les performances de son équipe si son rôle se limite soit à montrer l’exemple sans pouvoir sanctionner, soit à sanctionner sans pouvoir donner l’exemple. Enfin, l’efficacité d’un leader d’équipe ayant le pouvoir de sanctionner ses pairs augmente s’il est choisi par ses pairs plutôt qu’au hasard.
Les implications pratiques des résultats expérimentaux
Les résultats de l’expérience conduisent aux suggestions suivantes : les mécanismes centralisés fondés sur des incitations monétaires sont plus efficaces que la pression entre collègues pour accroître l’effort. Mais, ils risquent d’engendrer des gains très faibles ou très inégaux pour les salariés. De plus, les objectifs d’équipe ou la concurrence entre équipes peuvent dégrader l’ambiance de travail ou pire, inciter à des comportements délétères, comme saboter le travail des équipes rivales ou tricher pour améliorer artificiellement la performance de son équipe, comme Gary Charness, David Masclet et Marie-Claire Villeval l’avaient observé dans le cas de tournois individuels.
Les expériences de Klaus Abbink et de ses collègues ont aussi montré que les tournois collectifs risquent d’engendrer des conflits entre équipes ayant des coûts très élevés. Les entreprises doivent donc être prudentes dans la mise en œuvre de ce type de mécanisme.
Enfin, concentrer le pouvoir de sanction entre les mains d’un leader peut nuire à la performance de l’équipe si le choix du leader est perçu comme arbitraire et si le pouvoir de sanctionner ne s’accompagne pas de celui de donner l’exemple. Mais un leader qui donne l’exemple et peut sanctionner améliore durablement la performance de son équipe.
Ces expériences modélisent de façon simplifiée des mécanismes réellement utilisés en entreprise. Dans une expérience en laboratoire, notamment lorsqu’elle n’inclut pas d’effort réel, il n’y a pas de tâches à accomplir ayant un intérêt intrinsèque.
En entreprise en revanche, le contenu du travail joue un rôle important dans la motivation et constitue un levier grâce auquel le responsable peut inspirer, reconnaître et stimuler ses collaborateurs. Mais l’intérêt intrinsèque du travail à accomplir ne fait pas pour autant disparaître les effets des mécanismes d’incitation révélés par les expériences de laboratoire. En réalité, des mécanismes incitatifs bien conçus concourent, comme l’intérêt intrinsèque du travail, à la performance des équipes.
![]()
Marc Lebourges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Auteur : Marc Lebourges, Chercheur associé en sciences économiques, Université de Rennes
Aller à la source