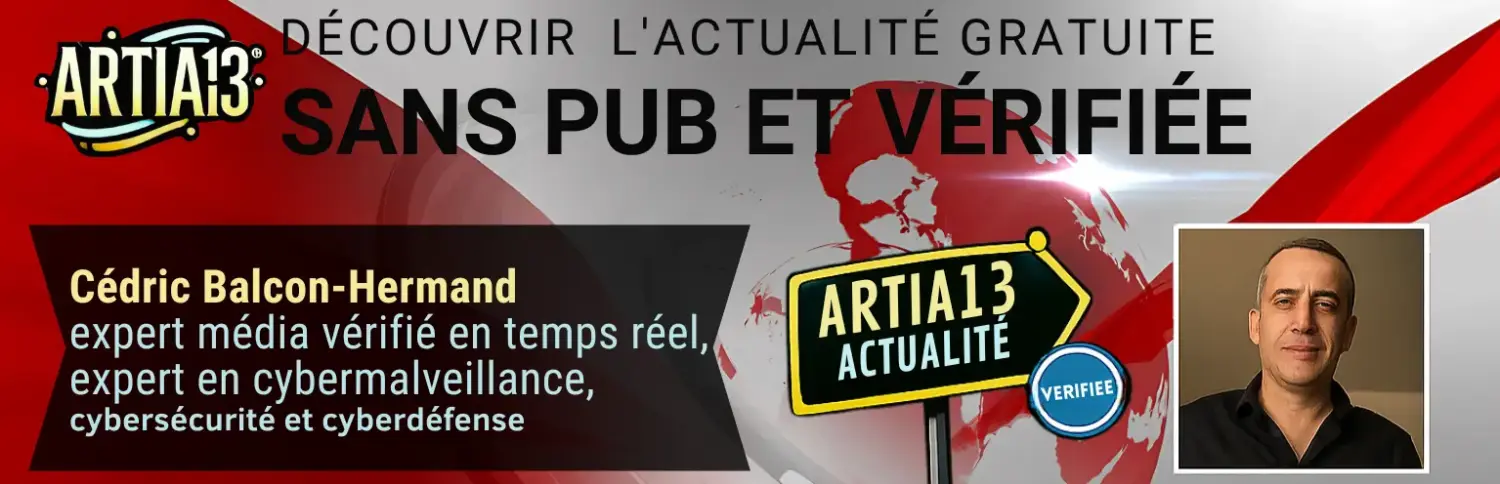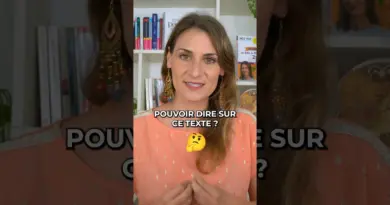Aussi indéfinissable qu’insaisissable, le kitsch prolifère partout, des musées les plus prestigieux aux vide-greniers. Une consécration paradoxale pour un phénomène dont l’essence même est son caractère commun.
Vieille d’un siècle et demi – si on la fait commencer avec l’apparition du mot lui-même, dans la deuxième moitié du XIXᵉ siècle, l’histoire du kitsch est celle d’une irrésistible extension dont, en 1939, le critique américain Clement Greenberg annonçait le caractère impérieux (et impérialiste) :
« Il a effectué un tour du monde triomphal, envahissant et défigurant les cultures particulières de chacun des pays qu’il a successivement colonisés ; il est en train de s’imposer comme une culture universelle, la première culture universelle qui ait jamais existé. »
Elle est aussi, depuis un quart de siècle notamment, celle d’une ascension non moins spectaculaire, lui ayant permis d’accéder aux lieux les plus prestigieux. Dans les expositions Pierre et Gilles au Jeu de Paume (2007) ou Takashi Murakami au château de Versailles (2010) se montre un kitsch débarrassé de tout relent de marginalité, géographique, sociale ou artistique. Le succès de Jeff Koons – détenant le titre d’artiste vivant le plus cher de l’histoire – est peut-être l’indice le plus certain d’un triomphe envahissant, insolent parfois, du kitsch.
Mais la possibilité même d’une apothéose est paradoxale pour un phénomène impliquant dans sa définition, dans son essence même, un caractère commun, bas ou indigne. Il est impossible de définir en quelques lignes un terme dont presque tous les penseurs qui l’ont abordé soulignent le caractère éminemment fuyant. « Le kitsch échappe comme un lutin à toute définition » écrit le philosophe Theodor Adorno. Cependant, on peut se rappeler utilement son étymologie probable. Celle-ci le rattache aux verbes exprimant en dialecte allemand mecklembourgeois l’action de bâcler (« kitschen ») ou de tromper sur la marchandise (« verkitschen »).
Se pourrait-il qu’il y ait dans ce mensonge le germe d’une sagesse ? Qu’à l’arrogance de la victoire se mêle parfois la lucidité d’un échec ?
Dialectique du kitsch
Il est arrivé plusieurs fois dans l’histoire de l’art qu’un mouvement reprenne à son compte le mot par lequel on a d’abord voulu le dénigrer, et en efface ou en renverse toute nuance péjorative : les mots « impressionnisme » ou « cubisme » étaient à leur début empreints d’un accent de raillerie qui s’est très vite dissipé.
Il en va tout autrement pour le « kitsch ». Celui-ci continue d’impliquer, quel que soit l’éclat de son triomphe, la présence d’une sous-valeur, une fausse valeur ou une contre-valeur. Dans la variété de nuances auxquelles elle peut donner lieu – humour ou cynisme, provocation ou ironie, et jusqu’au plus sincère enthousiasme –, l’adhésion au kitsch est toujours scindée : non l’oubli pur et simple d’un stigmate originel, mais une manière de faire avec lui, de l’intégrer dans une forme de dialectique.
N’est-ce pas là une sophistication inutile ? Est-il réellement besoin d’introduire une dialectique dans l’attrait que peuvent inspirer les couleurs criardes d’un nain de jardin ou les coûteuses surcharges de l’hôtel Luxor de Las Vegas ? Oui, en définitive. L’appréhension d’une œuvre kitsch suppose la présence active (même lorsqu’elle est enfouie) d’une inversion de sa valeur, d’un renversement possible : l’expérience esthétique (et, le cas échéant, critique) s’inscrit dans une tension ou dans la virtualité d’un basculement possible entre l’authentique et l’artificiel, l’unique et le sériel, le dérisoire et le grandiose.
Ce qui relève de la médiocrité aspire à s’élever, et la cuillère ou la salière se chargent alors d’ornements, le mug s’affuble des symboles de la haute culture (de la Joconde aux autoportraits de Frida Kahlo). À l’inverse, ce qui vise le sublime (celui des grands idéaux ou des beaux sentiments) fait naufrage (ou, plus prosaïquement, trébuche et se casse la figure) dans le poncif ou la mièvrerie : les éclats pharaoniques de l’Aïda de Verdi ou les innocences lisses des toiles de William Bouguereau.
L’intelligence du toc
« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », écrit Baudelaire dans un projet d’épilogue aux Fleurs du mal. Aussi curieux que le rapprochement puisse paraître, l’orgueil d’une alchimie anime à son tour cette esthétique du confort, cet « art du bonheur » (comme l’appelle, dans les années 1970, le sociologue Abraham Moles) qu’est le kitsch. Excepté qu’ici, il suffit de gratter un peu pour reconnaître dans l’or la dorure. Il reste pourtant quelque chose de cette alchimie en toc une fois que l’écaille dorée est tombée : l’échec lui-même, dans la richesse de ses nuances. On peut échouer un peu, beaucoup, à la folie, passionnément ou lamentablement. Ce qu’on perd en grandeur prométhéenne, on le gagne en complexité.
On peut appeler intelligence, au plus près de l’étymologie, ce qui, dans le kitsch nous incite à lire et à lier ensemble des éléments n’ayant en eux-mêmes rien de précieux ni d’éclairant ; ce n’est que par le réseau qu’ils forment, par la manière dont ils articulent et souvent renversent des matériaux enchevêtrés, qu’ils jettent une certaine lumière sur le monde.
Contre ceux qui y voyaient un phénomène frivole et sans conséquences, Theodor Adorno prônait la nécessité de prendre le kitsch au sérieux, en précisant « critiquement au sérieux ». À l’intelligence du kitsch exigée par le penseur de l’École de Francfort, extérieure à l’objet examiné, on pourrait en ajouter une autre : non plus celle qui le surplombe pour en percer à jour les mécanismes insidieux et néfastes, mais celle qui se loge auprès de lui et en lui. Celle-ci n’entre pas en contradiction avec la première : il serait appauvrissant et absurde de ne pas prendre en considération l’incitation au conformisme politique autant qu’esthétique, la dimension aliénante dénoncée par les grands penseurs de ce kitsch devenant, dans la célèbre formule de l’écrivain Hermann Broch, « le mal dans le système des valeurs de l’art ».
Mais une intelligence du kitsch peut aussi prêter attention à l’idée formulée par le philosophe Walter Benjamin : celle qu’un art devenu accessible au corps, un art qui se laisse enfin toucher, ouvre la possibilité d’un nouveau rapport à l’intériorité humaine. Ou à celle d’Umberto Eco rétorquant aux « apocalyptiques », effrayés par l’irrévocable déchéance de la culture que trahissent le succès du jazz et des films d’Hollywood, que le monde des communications de masse est, qu’on le veuille ou non, notre monde. Ou encore à celle de l’autrice new-yorkaise Susan Sontag rendant compte de la sensibilité « camp », ce « dandysme de l’ère des masses » où le connaisseur le plus délicat et le plus blasé trouve sa délectation dans l’objet kitsch précisément parce qu’il est tel : « Affreux à en être beau ! »
Le kitsch partout ?
S’il n’est peut-être pas faux de dire que le kitsch est omniprésent dans notre monde contemporain, ce n’est pas que la possibilité ne nous soit plus offerte d’expériences entièrement étrangères au kitsch, c’est que celui-ci est toujours susceptible de surgir à l’improviste ou de projeter son ombre n’importe où. Quel que soit le champ où on se situe, artistique, social, économique, politique ou religieux, on court le risque de glisser ou de culbuter vers lui, avec innocence ou lucidité, tendresse ou ironie, par provocation ou par instinct, sentimentalisme ou démagogie.
Des outrances effroyablement sirupeuses de la campagne électorale de Donald Trump, aux bigarrures de la dernière collection de Miuccia Prada, où la transgression des codes du luxe se veut aussi leur parodie, de l’orientalo-hellénisme ploutocratique de l’Atlantis de Dubaï au romano-byzantinisme mystique de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, d’André Rieu à Richard Wagner (exemple d’un « kitsch génial », selon Hermann Broch), de la Barbie « western rose » en vente dans un mall de Miami ou de Manilla au Barbie (2023), de Greta Gerwig où l’univers de la poupée de Mattel investit l’écran d’une manière si littérale qu’il en éveille de manière étonnante une forme de réflexivité…
Les positions monolithiques, surplombantes et dogmatiques s’avèrent de moins en moins capables de rendre compte d’un kitsch qui, en proliférant, a aussi amplifié ses registres, multiplié ses dimensions ou ses strates. Et qui nous oblige alors à le considérer au cas par cas, en tenant compte, à chaque fois qu’il paraît, de tous les éléments en présence au sein d’équations tantôt très élémentaires, tantôt très subtiles. Et dont on n’est pas certain de pouvoir dire, dans les meilleurs des cas, dans quelques œuvres rares, si elles aboutissent au succès ou à l’échec.
« Rater mieux encore. Ou mieux plus mal. Rater plus mal encore. Encore plus mal encore. »
Laquelle de ces quêtes, énoncées par Samuel Beckett, est celle de celui qui accepte dans son art d’avoir partie liée avec le kitsch ?
![]()
Franz Johansson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Auteur : Franz Johansson, Docteur en Littérature française, Sorbonne Université
Aller à la source