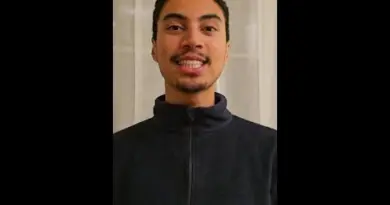Réinventer les universités : et si nous leur donnions une mission planétaire ?
Si elles veulent s’adapter à l’accélération des changements du monde et de la technologie, toutes les universités à travers la planète gagneraient à se réinventer. De quels atouts disposent-elles pour s’affirmer en « laboratoires de la transition » face aux défis actuels ?
Nous sommes aujourd’hui confrontés à ce qu’Edgar Morin a qualifié de « polycrise ». Des défis mondiaux de toutes sortes nous font face et menacent nombre de nos communs planétaires, et par là même la viabilité de notre espèce. Par communs planétaires, on entend les communs naturels comme le climat et la biodiversité, les communs culturels comme la confiance, la démocratie et l’éducation, ou encore les nouveaux communs numériques tels que les données « open source ».
Dans ce contexte, l’université est elle aussi à la croisée des chemins. Forte d’une histoire pluriséculaire de résilience et d’adaptation, héritière des idéaux des Lumières et ancrée dans les paradigmes hérités de la révolution industrielle, elle doit aujourd’hui adapter ses missions fondamentales – l’éducation, la recherche et le développement de la société – aux défis de notre temps.
Si elles veulent s’adapter à l’accélération des changements du monde et de la technologie, toutes les universités à travers la planète gagneraient à se réinventer.
Le modèle universitaire traditionnel est à bout de souffle
L’âge d’or de l’université semble révolu. Produit de la modernité en Occident, de ses avancées dans les idées et les technologies, elle en porte aussi les limites et perpétue (souvent de manière inconsciente) des paradigmes disciplinaires, et parfois un héritage colonial, patriarcal et extractiviste, enraciné dans l’histoire européenne.
Mais ce n’est qu’un aspect de la crise multidimensionnelle que traversent les universités aujourd’hui, une crise qui touche à leurs missions fondamentales d’éducation, de recherche et de contribution au développement des sociétés dans leur ensemble.
La mission éducative de l’université est remise en cause : les étudiants attendent d’être formés à des compétences qui leur permettront d’être acteurs du changement (dans l’entrepreneuriat, la durabilité, le numérique, la société) mais les structures universitaires, parfois rigides, ne parviennent pas toujours à adapter suffisamment vite leurs contenus et leurs formats aux besoins des jeunes face à l’urgence des transitions.
A contrario, les parcours académiques restent en grande majorité dans des cadres disciplinaires peu ouverts à une diversité de savoirs. Or, l’avenir de l’éducation repose sur la « polyversité », un modèle qui encourage la collaboration entre communautés pour relever les défis planétaires.
La mission de recherche de l’université est elle aussi en crise. Les enseignants-chercheurs évoluent dans un système qui valorise l’hyper-productivité (« publier ou périr », course aux financements…) et la compétition (mesurée par le volume de la production scientifique ou la renommée institutionnelle) en vue d’être les meilleurs au monde, alors qu’ils devraient aspirer à être « les meilleurs pour le monde ».
D’autre part, les universités se voient aujourd’hui concurrencées par des acteurs agiles et hybrides (entreprises, ONG, think tanks) plus aptes à proposer des solutions concrètes aux défis actuels, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), pourtant incontournable.
La dernière mission de l’université, celle de sa contribution au développement de la société, s’érode également. Les institutions universitaires manquent de ressources pour répondre assez rapidement et largement aux grands défis contemporains et sont trop souvent contraintes par des intérêts politiques ou économiques, comme en témoigne la situation aux États-Unis.
L’émergence de l’intelligence artificielle exacerbe la crise de l’université
L’évolution accélérée des modèles d’IA capable d’exécuter la majorité des tâches intellectuelles et cognitives pousse les universités à relever un défi plus grand encore. Elles sont déjà en passe de perdre leur monopole éducatif avec l’apprentissage personnalisé proposé par l’IA et risquent, à terme, de perdre leur rôle de productrices de savoirs puisque l’IA atteint désormais dans toujours plus de domaines une expertise qui peut mériter un prix Nobel.
Alors que la connaissance cesse d’être un « avantage compétitif » pour les universités comme pour les étudiants et les chercheurs, ceux-ci doivent repenser ce qui fait leur spécificité et montrer la valeur ajoutée de leur humanité. De plus, dans un monde saturé d’IA, les jeunes, déjà en proie à une santé mentale fragile, vont être affectés par les changements technologiques à l’œuvre, qui intensifient leur anxiété.
L’université a tous les atouts pour accepter sa mission planétaire
Face à cette polycrise, les universités n’ont d’autre choix que de redéfinir leur raison d’être : « Nous avons deux vies, et la deuxième commence lorsque nous réalisons que nous n’en avons qu’une » disait Confucius. Les universités entrent dans leur seconde vie : certaines sont déjà contraintes de fermer, beaucoup d’autres disparaîtront si elles ne s’adaptent pas.
L’institution universitaire a cependant toutes les cartes en main pour se réinventer et contribuer au monde de demain. C’est un lieu où les générations futures se rassemblent et où naît le changement, un espace où se cultivent les biens communs de l’humanité (les communs naturels, culturels et technologiques), un carrefour d’intelligences (intelligence personnelle, collective, artificielle), et un lieu où l’on peut imaginer de nouveaux modèles de gouvernance participative.
Face à la polycrise environnementale, sociétale, cognitive, sociale, technologique qui nous fait face, une transition de grande ampleur est nécessaire, et l’université, si elle sait se transformer, semble être l’unique organisation qui puisse agir comme « bâtisseur d’avenir ». En effet, elle seule détient des savoirs dans toutes les disciplines, relie les générations, les secteurs et les communautés, elle est ancrée localement, connectée globalement, et est mue par l’intérêt général.
Interdisciplinaire, intergénérationnelle, interculturelle, socio-écologique : l’université a la capacité d’endosser un rôle de tisserande de liens, à l’origine d’écosystèmes d’apprentissage et d’innovation capables de réparer, de retisser et de régénérer le tissu social et les communs planétaires.
Ce rôle de tisserande soutient la nouvelle mission de l’université : celle de faciliter la transition. Cette mission – transnationale et planétaire – intègre et revitalise les fonctions originelles de l’université : éducation, recherche et développement sociétal. Elle garantit que les universités à travers le monde s’emparent de l’urgente tâche de mener l’humanité vers des futurs durables, équitables et pacifiques.
L’université doit d’abord se réinventer de l’intérieur
Les universités ne peuvent servir de laboratoires de la transition si elles n’entrent pas elles-mêmes en transition. Elles doivent d’abord faire de la recherche pour réinventer leurs propres structures, pouvoir évoluer à l’arrivée de chaque nouvelle génération étudiante, et penser non seulement l’échelle nationale mais aussi l’échelle globale, avec, au cœur de leur stratégie, le bien-être de la planète. Mais elles doivent surtout incarner l’éthique du futur, une éthique basée sur la compassion et la solidarité.
De nombreux exemples existent déjà à travers le monde : des universités historiques comme Oxford University, développent des programmes fondamentaux sur les futurs et les enjeux mondiaux. D’autres universités comme Arizona State University intègrent durabilité, innovation et interdisciplinarité au cœur de leur cursus, tandis que les universités entrepreneuriales Utrecht et Aalto se concentrent sur la gestion des écosystèmes, la durabilité et le design régénératif.
Enfin, des écoversités comme Universidad de Medio Ambiente (UMA) ou UCI adoptent des approches régénératrices pour les communautés locales et mondiales, et des institutions comme le Learning Planet Institute, en partenariat avec l’Université des Nations unies et l’Unesco, se fondent sur le besoin de co-construire l’avenir avec les jeunes générations et des principes d’intelligence collective et de collaboration open source.
Chaque université, quelle que soit sa taille, sa région, sa place dans les classements de type “best in the world”, peut opérer un changement de mission en profondeur pour devenir “best for the world”, meilleur pour le monde.
C’est une opportunité historique dont l’ensemble des acteurs du système universitaire mondiale peuvent se saisir.
Cet article est une invitation à la discussion et à l’échange sur ces sujets. Nous ne souhaitons en aucun cas prôner un modèle uniforme, mais lancer une dynamique adaptable à chaque territoire, à chaque université où chacun·e peut contribuer à une démarche collective et à des futurs souhaitables.
Merci de partager vos initiatives, vos idées, vos projets, vos questionnements et contactez-nous pour engager la transformation des universités.
![]()
François Taddei a reçu des financements de l’ANR, du SGPI et de fondations. Il préside le Learning Planet Institute.
Pavel Luksha est directeur du groupe de réflexion Global Education Futures et conseiller stratégique du recteur de l’université de gestion d’Almaty (AlmaU). Il a reçu des financements de European Social Fund et de fondations.
Auteur : François Taddei, Président (Chief Exploration Officer), Learning Planet Institute (LPI)
Aller à la source