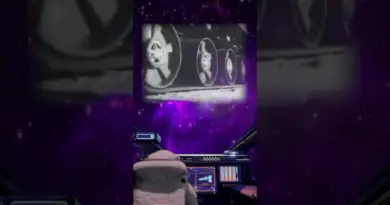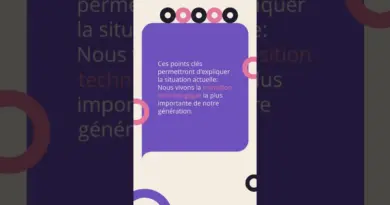États-Unis : nouveau feu vert de la Cour suprême à une présidence monarchique
Le 27 juin, par six voix contre trois – celles des six juges conservateurs contre les trois progressistes –, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision aux lourdes implications : les juges fédéraux ne pourront plus bloquer les décisions de l’administration Trump. Plus que jamais, le président a les mains libres pour appliquer ses décrets, y compris ceux qui contreviennent aux dispositions de la Constitution.
L’affaire qui a conduit à la décision prise par la Cour suprême le 27 juin touche au droit du sol. Signé en grande pompe par Donald Trump le jour même de son investiture, le 20 janvier 2025, le décret 14 610 stipule que les enfants nés de parents ne disposant pas de titre de séjour permanent valable (green card) ou n’ayant pas la nationalité américaine ne deviennent pas citoyens à la naissance.
Ce décret constitue une violation de ce que prévoient explicitement le 14ᵉ amendement à la Constitution, la loi sur la nationalité de 1940 et la jurisprudence de la Cour suprême elle-même : dans la décision U.S. v. Wonk Kym Ark de 1898, elle avait jugé que même si ses parents étaient « sujets de l’Empereur de Chine », un enfant né aux États-Unis était bien citoyen américain.
Un tour de passe-passe judiciaire
L’application du décret avait alors immédiatement été contestée par 22 États, des associations pour la défense des migrants et plusieurs mères enceintes souhaitant protéger les droits de leur enfant à naître, puis suspendue par trois juges différents saisis au Massachusetts, dans le Maryland et dans l’État de Washington. Ces ordonnances avaient ensuite été confirmées en appel.
Face à ce blocage, l’administration Trump a adressé à la Cour suprême une demande d’intervention d’urgence, dans laquelle elle demandait à la Cour de juger illégales les ordonnances dites « universelles » (Nationwide injunctions).
La Cour aurait pu refuser ce tour de passe-passe mais, une fois de plus, elle a refusé de jouer son rôle de contre-pouvoir. Le 27 juin, dans la décision « Trump vs. CASA » (CASA étant le nom d’une organisation d’aide aux migrants), elle a accédé aux désirs du président. Le moment et l’affaire choisis sont éminemment politiques : les initiatives de l’administration Biden en matière de vaccination obligatoire ou d’effacement de la dette des étudiants avaient été bloquées par ce type d’ordonnances universelles, et la Cour n’avait alors rien fait.
Durant l’audience du 15 mai, les questions posées par les juges conservateurs avaient reflété leur hostilité envers les ordonnances universelles, qui s’appliquent à tous ceux dont les droits risquent d’être violés, et pas seulement aux requérants et parties aux procès. Pourtant, alors que le risque était de créer le chaos avec des situations différentes selon les États, une ordonnance universelle se justifiait pleinement ici.
Cette pratique, qui est un phénomène récent (remontant sans doute à 1963), a connu un pic au cours des 20 dernières années et a été critiquée par les républicains comme par les démocrates, à des périodes différentes. Elle est due à une conjonction de facteurs. Parce que le Congrès est polarisé et dysfonctionnel, les présidents Obama, Trump et Biden ont eu recours aux décrets pour tenter de faire avancer leurs priorités politiques hors la voie législative. Leurs adversaires ont aussitôt saisi la justice fédérale en ayant soin de choisir une juridiction dont les juges partagent leur vision idéologique, ce qu’on appelle le forum shopping.
Les républicains intentent leurs actions au Texas et en Floride, qui relèvent de deux cours d’appel conservatrices (5e et 11e circuits). Les progressistes, eux, saisissent la justice à New York, dans l’Oregon ou à Hawaï, là où les juges sont plutôt progressistes et où les cours d’appel compétentes, celles des 2e et 9e circuits, sont encore progressistes malgré la nomination par Trump, durant son premier mandat, de 250 juges très conservateurs choisis par la Federalist Society pour leur fidélité idéologique.
La décision de la Cour suprême et ses conséquences
L’opinion majoritaire rédigée par la juge conservatrice Barrett est courte (33 pages) mais accompagnée de plusieurs opinions « séparées » – des opinions convergentes rédigées par les juges de droite qui auraient voulu aller plus loin, et deux opinions dissidentes par les juges progressistes.
La motivation de l’opinion majoritaire est extrêmement technique et s’appuie sur un pseudo-originalisme qui remonte à la naissance de l’Equity créé en Angleterre pour pallier les lacunes du droit de common law, et à la loi qui a créé le système judiciaire des États-Unis (Federal Judiciary Act, 1789) pour conclure que les juridictions fédérales ne jouissent pas du pouvoir de rendre ces ordonnances universelles.
La juge progressiste Sotomayor, auteur d’une longue opinion dissidente démontant le raisonnement de la juge Barrett, a décidé d’en lire des extraits (pendant 20 minutes) à haute voix, après l’annonce, par la juge Barrett, de la décision de la majorité. Cette pratique extrêmement rare, déjà utilisée par elle-même une fois cette année et plusieurs fois par la juge Ruth B. Ginsburg, icône de la gauche, vise à porter le débat au-delà du cercle restreint des juristes, et à souligner son désaccord profond avec la décision majoritaire et les dangers pour les libertés dont cette décision est porteuse.
La juge progressiste Jackson, dans une deuxième opinion dissidente, a le mérite de poser la question de façon plus directe encore. Les juridictions peuvent-elles s’opposer à un comportement illégal ou inconstitutionnel du président ? De son point de vue, la réponse est positive. Mais la juge Barrett, avec une once de condescendance, a rétorqué dans l’opinion majoritaire que la loi qui a créé l’organisation judiciaire (Federal Judiciary Act de 1789) n’a pas accordé aux juridictions fédérales ce pouvoir d’agir en Equity. Celles-ci ne peuvent donc pas violer le droit juste pour empêcher le président de violer celui-ci. « Les juridictions n’exercent pas un contrôle général de la branche exécutive ; elles résolvent des “controverses” et contentieux en vertu de l’autorité qui leur a été conférée par le Congrès. Quand une juridiction conclut que l’Exécutif a agi de façon illégale, la solution n’est pas que le juge excède lui aussi ses pouvoirs et fasse de preuve de suprématie judiciaire. », écrit Barrett.
L’interdiction de ces ordonnances à portée universelle signifie qu’il incombera désormais, dans les 28 États dirigés par les républicains qui n’ont pas contesté le décret en justice, à chacun des enfants (ou plutôt à leurs représentants, mères ou associations ou États) de saisir le juge afin de contester l’application du décret en invoquant la violation du 14e amendement.
La décision rendue ne s’appliquera qu’à cet enfant ou à ce groupe d’enfants, mais pas à la totalité des enfants nés de parents ne disposant pas de titre de séjour permanent valable. Dès que le délai de 30 jours fixé par la Cour sera écoulé, l’administration Trump pourra appliquer le décret dans ces 28 États, ce qui pourra amener des mères à tenter d’aller accoucher à New York ou dans le Massachusetts et qui, à terme, va creuser encore davantage le fossé entre États « rouges » (républicains) et États « bleus » (démocrates) protecteurs des droits attaqués par l’administration Trump.
Sur le plan logistique, et c’est ce que défendaient les États requérants, ce sera le chaos car les enfants se déplacent au cours de leur vie. Or, le statut de citoyen entraîne des droits et permet de bénéficier de certains services. Quid si un enfant né dans un État « rouge » (où les autorités auront refusé de le déclarer comme citoyen à sa naissance) vient vivre dans un État « bleu » ? Il n’aura pas les documents nécessaires et l’État ne percevra pas les subventions correspondantes du gouvernement fédéral (bons alimentaires par exemple). La décision majoritaire n’a pas entendu les États, mais ceux-ci peuvent continuer à agir et vont modifier leur requête en tenant compte de l’arrêt de la Cour.
Quid de la suite ?
Restent les recours collectifs (class actions) qui avaient occupé une bonne partie du temps lors de l’audience. Les avocats des requérants ont expliqué que constituer une action de groupe est compliqué et prend du temps.
Ils ont tenté de convaincre les juges que lorsqu’il y a urgence, ce n’est pas l’instrument idéal. La Cour ne les a pas suivis. Dès l’annonce de la décision, les groupes de défense des libertés ont donc déposé des demandes d’actions de groupe « nationales ». C’est ce qu’a fait l’association de défense des libertés fondamentales ACLU le jour même de la décision, le 27 juin, dans le New Hampshire et un autre groupe dans le Maryland.
Mais ce sera un parcours semé d’embûches car la Cour a progressivement rendu plus difficile la certification des actions de groupes : elle a, par exemple, refusé de façon spécieuse de certifier l’affaire Walmart en 2011. Ce sera donc au mieux complexe et lent, à la différence de ces ordonnances qui protègent avec effet immédiat tous ceux qui risquent de se voir privés d’un droit constitutionnel.
La Cour veut-elle encore être un contre-pouvoir ?
Le pouvoir judiciaire a été créé afin d’être un contre-pouvoir et le rempart protégeant les droits et libertés. C’est ce qu’ écrit Alexander Hamilton dans Le Fédéraliste n° 78, et ce fut la mission des juridictions durant la deuxième moitié du XXe siècle.
Mais aujourd’hui, avec la Cour Roberts (du nom de John Roberts, président de la Cour suprême depuis 2005), les droits fondamentaux sont en danger, et pas uniquement le droit du sol. Une dizaine d’autres ordonnances suspendent pour l’instant des décrets sans doute illégaux signés par Donald Trump : ceux qui bloquent les fonds votés par le Congrès, démantèlent les agences, limogent les fonctionnaires, s’en prennent aux transgenres et visent à modifier les règles électorales alors que celles-ci relèvent des États et, si besoin, du Congrès mais en aucun cas du président. Selon le texte du décret concerné, le libellé du recours et les requérants (États, particuliers), les juridictions vont devoir adapter leurs décisions en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour ce 27 juin.
En denier ressort, les affaires finiront devant la Cour suprême mais celle-ci, à la différence de la Cour Warren (1953-1969), ne cherche pas à ouvrir les portes de la Cour au maximum de justiciables et à les protéger. Elle veut limiter le nombre des bénéficiaires d’une décision favorable et la protection que peuvent procurer le droit et la Constitution à aussi peu de certains justiciables que possible. C’est apparu de façon évidente dans les questions et les développements des juges durant l’audience du 15 mai. Il s’agit, pour la Cour, de veiller à ce qu’un individu majeur ou mineur, qui risque d’être privé d’un droit, ne puisse pas bénéficier d’une décision qui n’a pas été le résultat d’une action en justice intentée par lui ou ses représentants.
Avec les trois juges nommés par Donald Trump à la Cour suprême durant son premier mandat, sélectionnés par la Federalist Society et approuvés grâce aux manœuvres de celui qui était alors le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, la Cour suprême est devenue la Cour des puissants et des nantis. Elle est enfin ce que voulaient l’avocat Powell (dans son Memo Powell de 1971) et ceux qui ont créé le mouvement conservateur dès les années 1970. Elle peut, par son interprétation des lois et de la Constitution, faire advenir des reculs (politiques, économiques et sociaux) qui ne peuvent passer par la voie législative. La droite est enfin parvenue à infléchir le droit en faveur des riches et puissants via la capture des juridictions et de la Cour suprême.
![]()
Anne E. Deysine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Auteur : Anne E. Deysine, Professeur émérite juriste et américaniste, spécialiste des États-Unis, questions politiques, sociales et juridiques (Cour suprême), Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Aller à la source