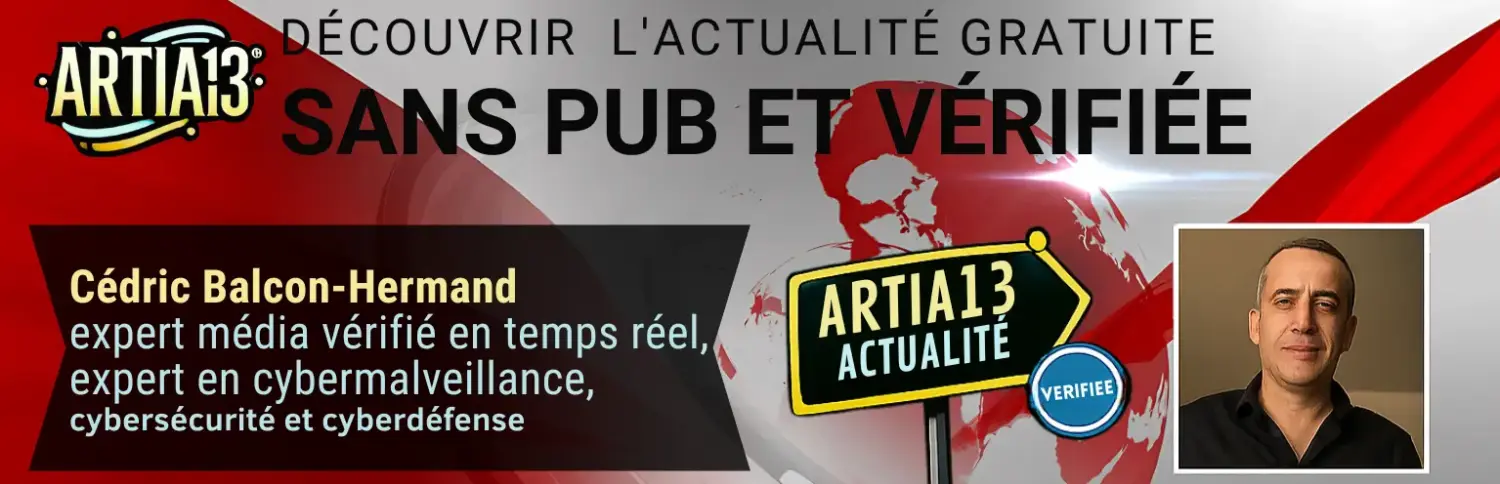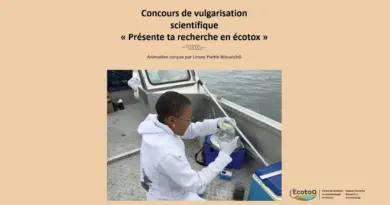Le premier état des lieux français des méconduites scientifiques montre le poids considérable des conflits entre chercheurs. Lesquels sont rendus inévitables par l’accentuation de la compétition entre eux. Mais la fraude scientifique est-elle vraiment mesurée ?
* * *
I
L Y A TOUT JUSTE DIX ANS, les accusations de fraude scientifique contre le biologiste Olivier Voinnet ébranlaient en profondeur la biologie française. Ce chercheur très en vue avait été exclu du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour deux ans – sanction gravissime – sans que l’organisme de recherche ne communique sur ce qui lui était reproché. Tout juste pouvait-on constater que huit de ses articles étaient rétractés du fait de manipulations injustifiées dans certaines de leurs figures.
Après le tremblement de terre, les répliques : coup sur coup, la directrice du département de biologie du CNRS, Catherine Jessus, puis la présidente par interim du CNRS, Anne Peyroche, furent accusées de méconduites scientifiques au premier abord comparables à celles reprochées à Olivier Voinnet, tout en étant sanctionnées de manière très nettement moins graves.
Ces affaires médiatisées conduisirent le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche de l’époque, Thierry Mandon, à confier une mission au respecté administrateur du Collège de France, le pharmacologue Pierre Corvol, dont l’excellent rapport de 2016 a fondé les bases d’un traitement institutionnalisé des manquements à l’intégrité scientifique, là où sévissaient auparavant omerta et cas par cas.
UN THERMOMÈTRE DES
DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RECHERCHE
En matière d’intégrité scientifique, il y eut un avant et un après rapport Corvol. L’essentiel des dispositions qu’il préconisait a été mis en œuvre. La loi définit à présent l’intégrité scientifique comme tout ce qui garantit le « caractère honnête et scientifiquement rigoureux » des travaux de recherche, définition suffisamment vague pour laisser à chaque discipline la possibilité de l’accorder à ses pratiques. Tous les établissements de recherche et d’enseignement supérieur ont nommé un référent intégrité scientifique, chargé d’instruire en toute indépendance les allégations de manquements en leur sein.
130 manquements à l’intégrité scientifique dans la recherche française en 2022 et 2023.
Enfin, un Office français de l’intégrité scientifique (Ofis) a pour mission de donner une cohérence nationale à cette politique. Il vient de publier ce 21 juillet ses recommandations visant à « renforcer l’équité et la transparence de la procédure de traitement d’un signalement et ainsi l’efficacité et la crédibilité du cadre législatif et règlementaire existant en France en la matière » et à offrir « une protection contre les remises en cause abusives des instructions menées par les référents à l’intégrité scientifique ». Parmi les principales nouveautés, la possibilité pour une personne condamnée de faire appel auprès de l’Académie des sciences, qui jouerait ainsi le rôle de juridiction de second degré.
L’Ofis a également rendu public le 28 mai dernier son premier rapport sur le traitement des manquements potentiels à l’intégrité scientifique en France. C’est en soi une bonne nouvelle, puisque ce rapport, à vocation bisannuelle, offrira à l’avenir un intéressant thermomètre des dysfonctionnements du monde de la recherche.
En 2022 et 2023, donc, au moins 130 manquements à l’intégrité scientifique ont été constatés dans la recherche française. Il ne s’agit là que d’une estimation basse – car un tiers des établissements n’a pas répondu à l’enquête de l’Ofis – mais fiable – car les poids lourds que sont les grands organismes de recherche et les principales universités figurent au nombre des répondants.
La biologie, la médecine, et les sciences humaines et sociales en tête.
La biologie et la médecine (55 cas) et les sciences humaines et sociales (32 cas) fournissent les gros bataillons, très loin devant la physique (4 cas) et les mathématiques (2 cas). En quoi consistent ces manquements ? Quarante cas relèvent des conflits entre auteurs pour la signature d’un article et 32 de plagiats, situations qui représentent plus de deux tiers des cas (différentes accusations peuvent coexister dans une même affaire). Le tiers restant est constitué des falsifications des résultats (18 cas), d’une gestion non appropriée des données (11), d’une entorse aux règles éthiques (6), d’une non déclaration de conflits d’intérêt (6), d’une fabrication de données (1) et, enfin, de diverses situations (11), comme celle dont Sciences Critiques a récemment rendu compte portant sur la non anonymisation des données de la recherche en sciences sociales.
FRAUDE ET PLAGIAT,
MÊME COMBAT ?
En soi, par les catégories qu’il mobilise, ce recensement illustre l’approche européenne des manquements à l’intégrité scientifique. Aux Etats-Unis, pays pionnier en la matière puisque les premiers scandales médiatisés remontent aux années 1970 et la création d’un Office of Research Integrity en matière biomédicale à 1993, ne sont considérés comme frauduleux et susceptibles de poursuites que les cas de fabrication, falsification et plagiat de données, qui ne représentent que 51 des 130 cas français.
L’approche européenne, au contraire, ne se limite pas à la notion de fraude et entend inclure tout ce qui relève des manquements à l’intégrité scientifique, également appelés méconduites, inconduites, ou pratiques de recherche questionnables, incluant les problèmes éthiques.
Le plus souvent, la fraude authentique coexiste avec d’innombrables autres atteintes à l’éthique scientifique.
Fort bien ! L’expérience – et le cas de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille dirigé par Didier Raoult n’a fait que le confirmer – montre que la fraude authentique coexiste le plus souvent avec d’innombrables autres atteintes à l’éthique scientifique. Qu’il faille se montrer sévère avec les essais cliniques illégaux ou les conflits d’intérêts non déclarés tombe sous le sens.
Mais qu’en est-il des problèmes de conflits entre auteurs pour la signature des articles, et même du plagiat, qui représentent les deux tiers des manquements à l’intégrité scientifique recensés par l’Ofis ? Après tout, ils ne menacent en rien la fiabilité des savoirs, ni le bien-être des personnes. Pourquoi donc leur accorder une telle importance ?
Pour qui n’est pas familier du monde scientifique, ces histoires de conflits de signature relèvent d’un curieux usage qu’un œil d’ethnologue décrirait mieux que nous n’allons le faire. Les règles sont au moins aussi complexes que celles de la parentalité chez les Achuars, et de surcroît nulle part explicitées.
Lorsque plus d’une demi douzaine de personnes, situation courante en biologie, sont signataires d’un article, dans quel ordre les inscrire ? Grosso modo, le premier signataire – dont l’histoire gardera le nom ! – est présumé avoir mené le travail et le dernier l’avoir dirigé. Mais que se passe-t-il quand le travail a été mené en collaboration entre plusieurs laboratoires ? Quand certains ont apporté des idées, d’autres un dispositif expérimental et les troisièmes analysé les résultats ?
L’impensé de tout cela est la question de l’individualisation dans la recherche, les chercheurs étant engagés dans une folle compétition entre eux.
Ces questions ne sont pas de pure rhétorique : il y va des carrières, car les commissions chargées des recrutements comme des promotions scruteront de très près cette place de l’impétrant dans l’ordre des signatures des articles qu’il fera figurer à son dossier. L’impensé de tout cela est la question de l’individualisation dans la recherche, les chercheurs étant engagés dans une folle compétition entre eux alors même que le travail qu’ils mènent est à l’évidence de nature collective.
LE PLAGIAT, UNE MENACE
POUR LES RELATIONS SCIENCES-SOCIÉTÉ ?
Les mêmes questions se posent à propos du plagiat, traqué depuis une quinzaine d’années dans l’enseignement supérieur puis dans la recherche, ce qui a donné naissance à des entreprises florissantes de logiciels comme à des officines spécialisées. On peut certes concevoir qu’il soit nécessaire d’enseigner aux étudiants le bon usage des citations et qu’il soit désagréable, pour un chercheur, de retrouver ses bonnes idées sous la plume d’un autre.
Mais en quoi est-il besoin de mobiliser tout le jeune dispositif de lutte contre les manquements à l’intégrité scientifique pour y faire face, alors que le plagiat est la seule des fraudes scientifiques à avoir une définition légale, à travers le droit de la contrefaçon ? Et qu’il est donc possible, fort d’une jurisprudence, à un chercheur s’estimant plagié de demander justice devant les tribunaux ?
Si une idée vraie, remarquablement formulée, est recopiée ad libitum, en quoi est-ce préjudiciable au savoir ?
Plus fondamentalement, en quoi le plagiat menace-t-il « le lien de confiance [des sciences] avec la société » que mentionne la loi définissant l’impératif d’intégrité scientifique ? Si une idée vraie, remarquablement formulée, est recopiée ad libitum, en quoi est-ce préjudiciable au savoir ? Il fut un temps, certes lointain, où être plagié était un honneur, car on avait su formuler de manière particulièrement judicieuse et pertinente une question.
Il semble vain de vouloir revenir à cette époque antérieure au droit d’auteur, introduit par Beaumarchais dans une fameuse allocution devant l’Assemblée nationale en 1791, mais ne peut-on tout au moins se poser la question de la propriété d’un résultat de recherche ? Pourquoi appartiendrait-il à des chercheurs, quel que soit l’ordre dans lequel ils figurent sur la publication, plutôt qu’au laboratoire qui les emploie ? Peut-être la pratique, aujourd’hui courante dans des domaines de la physique nécessitant la collaboration de centaines de personnes, de signer les articles du nom des laboratoires impliqués et non des chercheurs y travaillant va-t-elle se répandre ?
REMETTRE EN CAUSE LE SYSTÈME
Qu’il soit permis à l’auteur de ces lignes, qui soutint une thèse dans un laboratoire de neurobiologie à la fin des années 1990, de terminer par un souvenir personnel. Il était alors d’usage, et recommandé par les encadrants, de recopier de larges parties des introductions bibliographiques dans les précédentes thèses soutenues par des étudiants du laboratoire.
Il est plus facile de repérer le plagiat que la mauvaise science.
Si les problématiques avaient été bien posées, l’état du savoir ne demandant qu’à être actualisé, pourquoi ne pas reprendre ce que nos prédécesseurs avaient (bien) écrit ? Il y avait là une conception collective du travail de recherche, reposant sur la notion de laboratoire plus que sur celle de PI (Principal investigator, comme on dit aujourd’hui), qui entraînerait de nos jours l’annulation de la thèse et l’infamie de son auteur.
La physicienne Michèle Leduc, ancienne présidente du comité d’éthique du CNRS, observait en 2018 que « c’est surtout au plagiat qu’on fait la chasse. Une raison est sans doute qu’il est plus facile à repérer que la mauvaise science. On peut estimer aussi que c’est parce qu’il remet moins en cause l’ensemble du système qui produit la recherche aujourd’hui ». Propos que nous faisons entièrement nôtres.
Nicolas Chevassus-au-Louis, journaliste / Sciences Critiques.
* * *
Auteur : Anthony Laurent / Sciences Critiques
Aller à la source